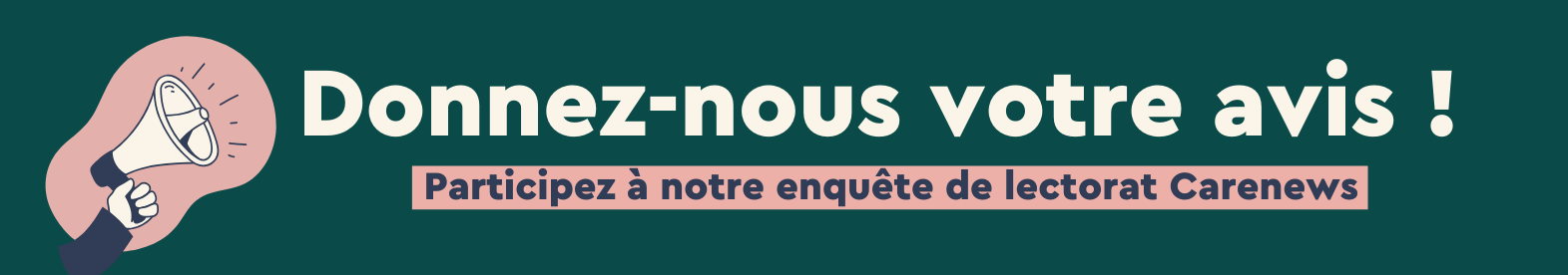L’alimentation durable, combat existentiel
L’alimentation durable, l’agriculture raisonnée, la préservation de notre environnement, la viabilité économique sont des enjeux cruciaux qui se trouvent au centre de positions contradictoires. Damien Conaré, secrétaire général de la Chaire UNESCO Alimentations du monde, apporte un éclairage entre action publique ou citoyenne et recherche académique avec une vision globale sur le sujet de l’alimentation. Comme tous les sujets qui touchent notre société et notre économie, ils doivent faire l’objet de débats où chacun entend l’autre et s’inscrivent dans des durées acceptables par tous.

l’alimentation durable et le rôle de l'UNESCO
-
Vous dirigez la Chaire UNESCO Alimentations du monde. Pouvez-vous commencer par définir l’alimentation durable et les différentes dimensions qu’elle recouvre?
Damien Conaré (DC) : C’est effectivement une notion complexe, mais dont la définition proposée par la FAO au début des années 2010 me semble toujours d’actualité. L’alimentation durable repose sur quatre piliers essentiels :
- la protection de l’environnement,
- l’équité sociale et culturelle,
- la santé et la nutrition,
- l’accessibilité économique.
Cette approche holistique permet de penser l’alimentation non pas comme une simple question de production ou de consommation, mais comme un système global qui relie agriculture, culture, économie, santé publique et environnement.
-
C’est donc dans cet esprit qu’a été créée la Chaire UNESCO Alimentations du monde ?
DC : Oui. La Chaire a été créée en 2011, avec l’idée de jouer un rôle d’interface entre la science et la société. Nous cherchons à faire le lien entre la recherche académique et l’action publique ou citoyenne.
Concrètement, notre travail s’articule autour de trois axes :
- La formation, avec notamment le Mastère Spécialisé Innovations et politiques pour une alimentation durable ;
- La coordination et la valorisation de projets de recherche, pour rendre plus visibles les travaux existants ;
- La diffusion des connaissances, à travers des conférences, des colloques et des publications.
Notre ambition est d’apporter une lecture scientifique et systémique de l’alimentation, mais aussi d’influencer les politiques publiques dans le sens d’une plus grande durabilité.
Production et environnement : vers des modèles agricoles durables
-
Venons-en à la production. L’alimentation durable suppose-t-elle de revoir les modes de production agricole, en particulier dans le sens d’une agriculture locale et résiliente ?
Absolument. Produire de manière durable, c’est avant tout respecter les ressources naturelles — les sols, l’eau, la biodiversité — mais aussi le travail humain. C’est une dimension souvent oubliée : la question sociale est aussi centrale que la question environnementale. Aujourd’hui, nous ne payons ni le juste prix environnemental ni le juste prix social de notre alimentation. Beaucoup d’agriculteurs vivent avec des revenus extrêmement faibles, alors qu’ils assurent une fonction vitale. La durabilité, c’est aussi redonner sa dignité économique et sociale au travail agricole.
-
Ces modèles reposent souvent sur de petites exploitations. Peut-on imaginer qu’ils s’appliquent à plus grande échelle ?
La taille n’est pas le seul facteur. Certes, la relocalisation concerne beaucoup le maraîchage, donc de petites surfaces. Mais on voit aussi dans les grandes exploitations céréalières des pratiques plus durables : replantation de haies, alternance des cultures, assolements… On peut donc, même sur de grandes surfaces, avoir des modèles plus vertueux.
-
Pourtant, certains producteurs abandonnent le bio faute de rentabilité. Est-il possible de faire vivre ces modèles autrement ?
C’est l’un des défis majeurs. Le modèle économique de l’agriculture durable dépend très largement de la politique agricole commune (PAC). Celle-ci représente près de 40 % du budget européen et constitue un levier considérable.
Mais aujourd’hui, les aides sont encore trop souvent conditionnées à la taille des exploitations ou au volume produit, plutôt qu’à la qualité des pratiques. Cela entretient une forme de dépendance et freine les transitions. Si la PAC réorientait davantage ses soutiens vers les modes de production respectueux de l’environnement et du travail, la durabilité deviendrait réellement économiquement viable.
Économie et politique : repenser le contrat social alimentaire
-
Vous évoquez souvent des expériences locales, des initiatives de terrain. Peuvent-elles vraiment transformer le système ?
Ces expériences sont essentielles, car elles montrent des voies possibles. Elles prouvent qu’une autre agriculture, plus juste et plus durable, est praticable. Certes, elles restent parfois marginales à l’échelle nationale, mais leur valeur est symbolique et structurante.
Prenez les circuits d’approvisionnement de la restauration collective : à Montpellier, par exemple, la ville a engagé un travail de fond pour améliorer la qualité des repas dans les cantines. Cela ne représente qu’une faible part de la consommation totale des habitants, mais c’est une vitrine : cela touche les enfants, donc les citoyens de demain.
-
Pouvez-vous détailler ce qui a été fait à Montpellier ?
Oui, c’est un exemple particulièrement inspirant. La ville a introduit dans ses appels d’offres la notion de goût, permettant d’évaluer la qualité et non seulement le prix. Elle a également pratiqué ce qu’on appelle l’allotissement : au lieu de grands lots inaccessibles aux petits producteurs, elle a multiplié les lots pour permettre aux exploitations locales de répondre. C’est un choix politique fort, car cela demande beaucoup de travail administratif et juridique, mais cela a permis de favoriser les circuits courts et d’améliorer la qualité des repas.
-
Et cela ne coûte pas plus cher ?
Pas nécessairement. Prenons l’exemple du pain bio. Il était plus cher à l’achat, mais de bien meilleure qualité. Les enfants l’appréciaient davantage, donc ils en jetaient beaucoup moins. Résultat : le surcoût a été compensé par la baisse du gaspillage.
-
Vous travaillez aussi sur la précarité alimentaire.
C’est un sujet majeur. La crise du Covid a mis en lumière l’ampleur de la précarité alimentaire, avec de nouveaux publics concernés. Le système d’aide alimentaire classique — Restos du Cœur, Banques alimentaires, Secours populaire, Croix Rouge — demeure absolument essentiel, mais il ne suffit plus. Nous observons une diversification des formes de solidarité alimentaire : épiceries sociales, groupements d’achat solidaires (comme le réseau VRAC) ou encore expérimentations de caisses alimentaires communes.
À Montpellier, par exemple, une caisse collective permet aux habitants de contribuer selon leurs moyens : certains donnent plus, d’autres moins, mais tous reçoivent 100 € à dépenser dans des commerces conventionnés par un comité citoyen et qui proposent des produits de qualité. C’est une forme de démocratie alimentaire locale, soutenue par la ville, la métropole, la Fondation Carasso et la Banque des Territoires.
Environnement : pesticides et intrants
-
Venons-en à la question des pesticides et des intrants. Comment concilier la nécessité de produire et la protection de l’environnement ?
C’est une question complexe, car tout le monde est conscient de la difficulté du métier d’agriculteur aujourd’hui : pression climatique, parasites, instabilité économique. Mais continuer à s’appuyer uniquement sur les produits phytosanitaires et les intrants chimiques s’apparente à une fuite en avant. Ces substances détruisent progressivement la vie des sols, la biodiversité, les pollinisateurs et, in fine, fragilisent notre appareil productif. Sans compter leur impact avéré sur la santé humaine, au premier rang desquels celle des agriculteurs eux-mêmes qui y sont le plus exposés.
-
Vous parlez d’un nouveau contrat social.
Oui. Le contrat social d’après-guerre reposait sur une promesse claire : nourrir toute la population à bas coût. Il a été rempli, mais au prix d’externalités environnementales et sociales considérables.
Il faut désormais repenser ce contrat : accepter de payer le juste prix de notre alimentation — qui intègre le coût environnemental et social — tout en assurant l’accessibilité pour les plus vulnérables.
Aujourd’hui, nous payons notre alimentation trois fois : à la caisse ; via la Sécurité sociale pour la prise en charge des maladies liées à une alimentation insuffisamment saine et par les coûts de dépollution. Rebâtir un modèle gagnant-gagnant est un enjeu de société : il s’agit de concilier santé, environnement et équité.
Gouvernance et renouvellement du monde agricole
-
Ce modèle repose sur les agriculteurs eux-mêmes. Mais qui produira demain ?
C’est un point d’inquiétude. Le monde agricole vieillit : beaucoup d’exploitants approchent de la retraite et il y a peu de repreneurs.
Nous voyons émerger de nouvelles formes d’installation : exploitations collectives, travail à temps partagé ou projets agricoles intégrés dans des parcours de vie. Une génération arrive, attirée par le sens du métier, mais qui veut aussi préserver son équilibre de vie.
-
Ces transformations modifient-elles la structure même de l’agriculture ?
Oui. En parallèle, on assiste à un mouvement d’agrandissement et de financiarisation des exploitations. Le travail, la terre et le capital ne sont plus détenus par la même personne. Cela bouleverse le modèle traditionnel où l’agriculteur maîtrisait son outil de production.
-
Et la loi d’orientation agricole ?
Malheureusement, elle reste très conventionnelle. Le mot “agroécologie” n’y figure même pas. Elle prolonge un statu quo alors qu’il faudrait reconnaître la diversité des formes d’agriculture et soutenir les nouvelles formes d’installations. Certains groupes de pression ont dévoyé ce débat en opposant simplification et écologie, alors que l’enjeu est de mieux répartir la valeur ajoutée tout au long de la chaîne alimentaire.
-
Ces enjeux dépassent la France…
Tout à fait, ces sujets se retrouvent à l’échelle mondiale, dans un contexte de pression concurrentielle et de dépendances alimentaires fortes. On parle de plus en plus de souveraineté alimentaire, de la capacité à relocaliser certaines productions essentielles. Mais pour y parvenir, cela nécessitera aussi une vision collective de long terme et un accompagnement politique fort.
-
L’alimentation durable est donc à la croisée de multiples enjeux : environnement, santé, économie, justice sociale…
Absolument, c’est à la fois un concept, une trajectoire et un combat politique. Nous avons franchi une étape de conscience, mais il faut maintenant traduire cette conscience en action. L’alimentation durable, ce n’est pas une utopie : c’est une nécessité pour préserver nos ressources, nos territoires et notre santé collective.
Lire aussi le passionnant compte rendu des Rencontres de l’alimentation durable organisées par la fondation Carasso.