« S’engager sans se cramer » : Hélène Balazard et Simon Cottin-Marx s’intéressent à la santé mentale des bénévoles
Les militants sont sujets au mal-être, voire au burn-out, en raison de leur engagement, montrent Hélène Balazard et Simon-Cottin Marx. Dans un ouvrage, les chercheurs réfléchissent aux manières de protéger leur santé mentale. Interview.
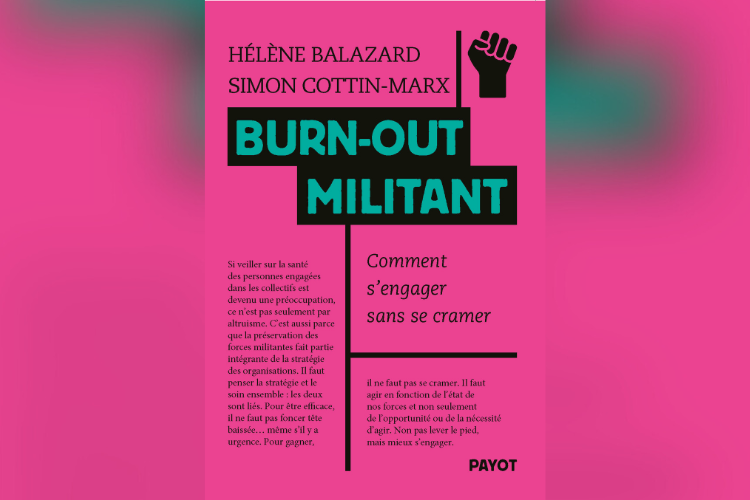
Hélène Balazard est chercheuse en sciences politiques : elle travaille notamment sur l’action collective et les mouvements sociaux. Simon Cottin-Marx est sociologue, spécialiste du monde associatif. Dans le livre Burn-out militant (Payot, 200 pages), ils partagent des solutions concrètes mises en pratique par des collectifs pour protéger la santé mentale des bénévoles, qu’ils agissent dans des associations, des syndicats, des partis politiques ou des collectifs plus informels.
- Carenews : Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser au burn-out militant ?
Simon Cottin-Marx : Le point de départ de ce livre est une discussion avec des militantes, qui m’ont appris qu’une association écologiste très connue, parisienne, avait explosé à la suite d’un burn-out collectif.
C’est regrettable car on a besoin des militants pour changer le monde et sauver la planète ! Je me suis demandé comment faire en sorte que les collectifs ne s’épuisent pas et puissent militer dans la durée.
- Avez-vous un moyen d’évaluer la prévalence du mal-être, voire du burn-out, parmi les bénévoles associatifs ?
SCM : Il n’y a pas d’enquête quantitative. Mais des enquêtes qualitatives ont été réalisées sur des mouvements des droits civiques et des droits humains, et sur des associations comme Aides. Ce que montrent ces études, c’est que l’épuisement militant concerne un nombre significatif de personnes. Dans le mouvement pour la paix et le mouvement ouvrier aux Pays-Bas, étudié par le psychologue Bert Klandermans, il concerne jusqu’à 10 % des bénévoles.
Quand nous avons commencé à parler de burn-out militant, nous n’avons pas eu de mal à trouver des gens qui avaient envie de nous parler leur expérience.
- Dans l'ouvrage, vous expliquez comment des collectifs peuvent prendre soin de la santé mentale de leurs membres.
Hélène Balazard : Oui, on revient en introduction sur la définition du burn-out militant mais le sujet du livre, c'est plutôt « comment s’engager sans se cramer », le sous-titre, que la question du burn-out militant en tant que telle.
SCM : Il n’y a pas de solution toute faite. Les collectifs doivent trouver ce qui est adapté à leurs membres, à leur organisation, à leur projet politique. Nous essayons de transmettre dans ce livre une culture du soin militant.
- À qui vous adressez-vous ?
HB : Nous avons souhaité faire un ouvrage plutôt grand public, qui s’adresse aux militants, aux bénévoles, aux salariés qui côtoient des bénévoles et potentiellement aux agents publics et élus qui ont envie que ces militants continuent à faire vivre la société. Ce n’est pas une enquête purement scientifique, il n’y a notamment pas d’enquête quantitative, même si nous avons reçu beaucoup de témoignages lorsque nous avons lancé un appel.
SCM : Le livre s’adresse à toutes les personnes qui s’engagent pour un projet social et écologiste.
- Vous parlez de « culture du sacrifice ». Est-on plus à même de mettre en danger sa santé quand on agit pour « la bonne cause » que quand on travaille ?
HB : Oui et non. Le risque de burn-out est très élevé dans le monde du travail, notamment dans les métiers qui ne sont pas utiles socialement.
Mais quand on travaille, normalement, il y a des personnes dédiées à la bonne gestion des ressources humaines, du droit du travail, un cadre de prise en charge de cette question de santé au travail. Ce n’est pas le cas pour le militantisme et le bénévolat. Nous citons trois facteurs aggravants du risque de burn-out militant, en plus des facteurs de risque qui sont les mêmes que dans le monde du travail.
Le premier, c’est la culture du sacrifice, lorsqu’on se sacrifie pour la cause, qu’on s’engage sans compter. C’est plutôt propre au militantisme, même si ça peut être le cas au travail.
Un autre facteur, c’est ce que nous appelons l’impossible prise en charge du bien-être dans les collectifs. Ça fait du bien de s’engager, mais on ne s’engage pas pour prendre soin de soi. Plutôt pour aider les autres, faire avancer la cause. Or, il y a toujours mieux à faire que de penser à soi ou à la santé du collectif. Les collectifs ne se disent pas spontanément « il faut qu’on fasse un travail pour prendre soin des bénévoles et militants ».
Un troisième facteur, c’est la répression, qu’elle soit administrative, policière, issue de l’extrême droite, dans la rue et sur les réseaux sociaux.
SCM : Oui, il y a la répression, mais il y a aussi l’apathie des pouvoirs publics qui joue un rôle dans l’épuisement des militants. Les organisations ont beau avoir raison sur les violences faites aux femmes, le racisme ou le changement climatique, rien ne se passe dans l’action publique.
À lire aussi : Burn-out : comment la dégradation des conditions de travail dans les entreprises menace la santé des salariés 
- Vous citez beaucoup d’exemple de « bonnes pratiques » individuelles et collectives pour préserver la santé des militants et des bénévoles. Cela peut donner l’impression qu’elles sont généralisées, et pourtant vous parlez de cette « impossible prise en charge du bien-être ». La prise de conscience face aux risques pour la santé des bénévoles et des militants est-elle suffisante ?
HB : D’après notre appel à témoignage, la prise de conscience est assez rare. Elle vient essentiellement des grands collectifs, qui ont subi beaucoup de répression, comme les Soulèvements de la terre qui faisaient face à de la violence physique directe. L’épuisement, au contraire, est plutôt insidieux, il arrive petit à petit.
Quand la violence vient de l’extérieur, c’est possible de la gérer, mais c’est encore assez dur de prendre en charge les conflits internes. On est loin d’avoir des collectifs organisés pour anticiper les problèmes relationnels interne sans créer trop de souffrance.
SCM : En effet, c’est une question qui a émergé dans des mouvements spécifiques, comme les Soulèvements de la terre mais aussi le mouvement antiraciste ou féministe, qui est particulièrement ciblé par l’extrême droite et concerné par les désillusions.
Ceci dit, le mot burn-out permet de décrire une réalité qui existe depuis très longtemps. Des pratiques préexistaient, comme celles consistant à veiller à donner la parole à tout le monde dans les syndicats et les associations, par exemple, ou les caisses de grèves, qui apportaient un soutien matériel aux militants.
- Les organisations agissent pour des causes qui paraissent urgentes. Ont-elles du temps pour prévenir les risques de dégradation de leur santé mentale et s’organiser ?
HB : Notre argument est de dire que ça vaut le coup de penser à cela, même si ça prend un peu plus de temps à court terme. Sur le moyen et long terme, il y aura moins de turnover, de collectifs qui exploseront, de gens épuisés qui arrêteront de s’engager.
Certains types d’engagement restent épuisants, et il faut anticiper des pauses, pour que l’épuisement de quelques personnes ne mette pas fin au collectif et à la mobilisation. On ne devrait pas culpabiliser à mettre en pause notre engagement si on a besoin de prendre soin de soi.
- L’engagement se déroule sur du temps personnel, donc peut vite déborder sur la vie personnelle. Comment prévenir ce risque ?
SCM : Il y a des solutions individuelles dont nous parlons dans le livre et évidemment, les individus ne sont pas égaux face au risque d’épuisement, mais les solutions sont principalement collectives. Nous faisons très attention à ne pas adopter une approche de développement personnel qui serait trop psychologisante. C’est aux collectifs militants, dans l’organisation du travail militant, de mettre en place des garde-fous. C’est aussi important d’avoir des relations sociales en dehors de son cercle militant. Pour pouvoir couper mais aussi gérer les situations conflictuelles plus sereinement.
L'association Nous toutes, par exemple, met en place des coupures numériques : après 19 heures et le week-end, on ne s’envoie plus de messages. D’autres associations, comme Juste Action Climat, font attention à ne pas se fixer des objectifs qu’elles n’ont pas le moyen de tenir sans s’épuiser. Dans le livre on donne de nombreux exemple d’organisation du travail militant soutenable.
- Vous insistez sur la nécessité de créer des moments de joie ou de rire, et de célébrer les victoires, même petites. Pour quelles raisons ?
HB : Les sujets pour lesquels on s’engage ne sont pas toujours très joyeux, voire même parfois un peu déprimants. C’est bien de rééquilibrer un peu l’horreur à laquelle on peut faire face.
Ces moments permettent aussi de se serrer les coudes, se donner de la force collectivement et créer une histoire commune, ce qui donne envie de s’engager sur le long terme.
Ils redonnent du sens aussi : une meilleure société, c’est une société dans laquelle les gens sont soudés, joyeux, peuvent faire la fête facilement. C’est la société vers laquelle nous voulons aller.
SCM : Beaucoup d’études montrent que faire la fête, mettre de la joie dans le travail militant, c’est bon pour la santé. Face à des situations difficiles, les individus et les collectifs peuvent s'apitoyer : ça participe à dégrader leur santé, notamment psychique. Avoir des moments de convivialité les aide à tenir.
- Un des facteurs de risque du burn-out au travail est le manque de reconnaissance. Comment rétribuer un engagement bénévole ?
SCM : Plusieurs collectifs fêtent énormément de petites victoires, l’arrivée d’un nouveau militant, les réalisations de chacun, comme organiser une manifestation ou rencontrer un élu. Dans des assemblées générales ou des journaux internes, on souligne la contribution de militants dans l’année.
Les rétributions sont symboliques, elles relèvent de la reconnaissance par les pairs et le monde extérieur. Et toute cette reconnaissance fait du bien.
HB : Le travail militant n’est pas reconnu, ni suffisamment valorisé, dans la société, qui tourne pourtant beaucoup grâce aux bénévoles. Il faudrait à terme repenser tout notre modèle économique pour mieux valoriser, en temps et en ressources, les différents engagements pour la société.
Propos recueillis par Célia Szymczak 

