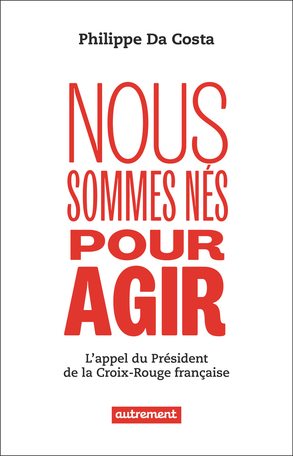« L’engagement associatif a été pour moi la meilleure école de la vie », entretien avec Philippe Da Costa, président de la Croix-Rouge française
Dans un ouvrage récent, le président de la Croix-Rouge française évoque son parcours personnel. Il retrace également l’histoire de la Croix-Rouge, évoquant son rôle essentiel pour répondre aux crises qui se multiplient.

Le Comité international de la Croix-Rouge est né il y a plus de 160 ans. Il est devenu depuis l’un des principaux acteurs de l’aide humanitaire sur les zones de conflit. À ses côtés, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge interviennent dans chaque pays pour soutenir les populations vulnérables et frappées par les crises.
Philippe Da Costa est président de la Croix-Rouge française depuis 2021 et jusqu’en juin prochain. Dans un livre récent, Nous sommes nés pour agir (éd. Autrement, 2024), il retrace son parcours personnel et explique pourquoi il est si important, à ses yeux, d e s’engager. Entretien.
- Carenews : La Croix-Rouge est un mouvement international de plus de 160 ans. Comment est-il né et comment s’organise-t-il aujourd’hui ?
Philippe Da Costa : La Croix-Rouge est née sur un champ de bataille, en 1859. L’homme d’affaires franco-suisse Henry Dunant, qui part à la rencontre de l’empereur Napoléon III, traverse alors Solférino, où vient d’avoir lieu la bataille entre les armées françaises et sardes et les armées autrichiennes. Il est horrifié par la vision des 6 000 morts et 40 000 blessés liés au combat. Il organise les secours des blessés des deux camps, aidé de civils volontaires. C’est ainsi qu’il invente les sociétés de secours aux blessés militaires.
Sous son impulsion et celle de quelques autres notables suisses, naîtra en 1863 le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui pose les bases du droit international humanitaire et des futures Conventions de Genève, qui régissent ce droit. Le rôle du CICR est toujours d’intervenir dans les zones de conflit, pour porter secours aux victimes et aux populations.
Parallèlement, se sont développées des sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge française a ainsi été créée dès 1864, par Henry Dunant lui-même. Il existe aujourd’hui 191 sociétés nationales, qui travaillent avec plus de 16 millions de bénévoles, et qui sont regroupées dans une Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Leur rôle est d’intervenir dans les pays sur des catastrophes naturelles ou des crises humanitaires. Elles peuvent aussi avoir d’autres missions, en fonction de l’histoire de chaque pays, comme c’est le cas en France.
- Comment définissez-vous le rôle de la Croix-Rouge française aujourd’hui ?
La Croix-Rouge française, ce sont 1000 implantations locales et 600 établissements et services (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, instituts de formation, crèches, Ehpad, soins de suite…), qui travaillent avec 75 000 bénévoles et 20 000 salariés.
Depuis 2017, nous avons redéfini la stratégie de l’association autour de trois piliers. Le premier est d’éduquer : nous jouons un rôle essentiel dans la formation et la sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent, notamment. Le deuxième pilier consiste à protéger : lorsque surviennent des inondations, des cyclones, ou d’autres catastrophes, notre rôle est de mettre à l’abri les populations, de les écouter, les soutenir psychologiquement ; mais nous intervenons aussi sur l’hébergement d’urgence ou encore la santé. Quant à notre troisième pilier, nous l’avons intitulé « relever » : il ne s’agit pas seulement de gérer les crises dans l’urgence, mais aussi de soutenir les personnes fragiles, par l’aide alimentaire ou vestimentaire, par la création d’emplois d’insertion, par un soutien psychosocial, etc.
La Croix-Rouge française, ce sont 1000 implantations locales et 600 établissements et services, qui travaillent avec 75 000 bénévoles et 20 000 salariés.
- Vous êtes devenu président de la Croix-Rouge française en 2021, après avoir côtoyé l’association de diverses manières depuis vos 17 ans. Vous racontez ce parcours dans votre livre, que vous avez choisi d’intituler Nous sommes nés pour agir. Pourquoi ce titre ?
J’ai choisi ce titre, qui est repris d’une phrase tirée des Essais de Montaigne, car pour moi, la raison d’être de la Croix-Rouge, c’est d’agir. À travers ce titre, je souhaite appeler à l’action, pour ne pas subir, ne pas se résigner. Pour moi, il est essentiel d’agir, notamment en s’engageant.
- De parents portugais, d’origine modeste, vous êtes arrivé en France à l’âge de cinq ans. En quoi l’engagement associatif vous a-t-il aidé dans votre parcours ?
J’ai grandi dans une famille aimante et empathique, qui m’a transmis le goût d’aller vers l’autre. On m’a toujours appris à donner sans compter, avec l’idée qu’on reçoit plus que ce qu’on donne.
Dès mes 17 ans, je me suis engagé à la Croix-Rouge, dans le comité local de Poligny (Jura), comme secouriste. Puis je me suis engagé plusieurs années dans le scoutisme. Cela m’a permis de découvrir des choses que je n’aurais jamais découvertes, de côtoyer des gens que je n’aurais jamais côtoyés, mais aussi de gagner de la confiance, de la reconnaissance et des compétences. Cela a été pour moi la meilleure école de la vie.
Cela m’a conduit à travailler quelques années chez les Scouts de France, puis comme directeur de la vie associative à la Croix-Rouge, avant de me diriger vers le secteur mutualiste : à la Macif puis aujourd’hui chez AG2R-La Mondiale, où j’occupe le poste de délégué général, puisque la présidence de la Croix-Rouge est une fonction bénévole. Cela s’est également fait grâce à de belles rencontres au cours de mon parcours.
Je crois que le rôle de la Croix-Rouge, c’est aussi de donner ces possibilités aux jeunes générations, de leur donner de la reconnaissance, de les accompagner à saisir des opportunités. Et de fait, nous avons énormément de jeunes parmi nos bénévoles.
Le rôle de la Croix-Rouge, c’est aussi de donner ces possibilités aux jeunes générations, de leur donner de la reconnaissance, de les accompagner à saisir des opportunités.
- Dans un contexte de rigueur budgétaire, qui a des conséquences inquiétantes sur de nombreuses associations, quelle est la situation financière de la Croix-Rouge française ?
La situation de la Croix-Rouge française est assez spécifique dans le paysage associatif. Nous avons trois grandes sources de revenus. La première, la principale, est liée à nos établissements sanitaires et médico-sociaux, pour lesquels nous sommes financés par des prix de journée. Dans ce domaine, le contexte est complexe, le secteur privé non lucratif ayant été le grand oublié du Ségur de la santé. Nous avons engagé des démarches de revalorisation des rémunérations de nos salariés, mais celles-ci n’ont pas toujours été compensées par les collectivités territoriales, ce qui fragilise nos équilibres financiers.
Deuxième source, les activités génératrices de revenus, comme nos boutiques de seconde main, nos formations au secourisme, ou nos postes de secours, etc. Elles contribuent à financer une partie de nos actions en matière sociale notamment, qui ne bénéficient pas de ressources propres.
Enfin, nous recevons des dons, qui sont indispensables. Il peut s’agir de dons dédiés à des causes spécifiques, par exemple la guerre en Ukraine, le cyclone Chido, le tremblement de terre au Maroc, ou de dons non dédiés, qui contribuent à financer l’ensemble de nos actions.
Au total, notre budget annuel est d’environ 1,8 milliard d’euros, dont 450 millions d’euros de bénévolat valorisé. Nous n’avons pas encore clos les comptes pour 2024, mais nous serons sans doute en léger déficit. Ce qui est notablement lié au sous-financement des engagements publics en matière médico-sociale et sociale, telle que la protection de l’enfance, par exemple.
Nous n’avons pas encore clos les comptes pour 2024, mais nous serons sans doute en léger déficit. Ce qui est notablement lié au sous-financement des engagements publics en matière médico-sociale et sociale.
Comme tous les acteurs associatifs, notre modèle économique subit donc des difficultés, d’autant plus que dans ce contexte de crise, les besoins sociaux auxquels nous devons répondre sont plus importants. Nous sommes en plein questionnement sur ce sujet.
Propos recueillis par Camille Dorival