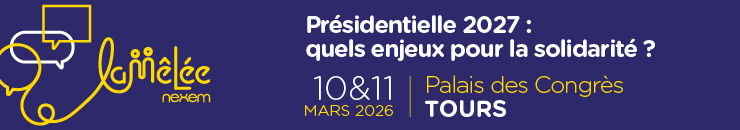« Les politiques climatiques sont aussi des politiques de santé publique » (Kévin Jean, épidémiologiste)
Presque tous les scénarios pour atteindre la neutralité carbone ont aussi des bénéfices en termes de santé, montre Kévin Jean, épidémiologiste, professeur junior en Santé et changement globaux à l'ENS-PSL, dans cette interview. À ses yeux, il s’agit d’un levier important pour mobiliser dans la lutte contre le changement climatique.

Améliorer notre santé, une raison de plus d’agir pour le climat ? Kévin Jean, épidémiologiste, professeur junior en Santé et Changement Globaux à l'ENS-PSL, travaille sur les bénéfices de santé résultant des politiques visant à atteindre la neutralité carbone. Dans cette interview, il explique que ces bénéfices peuvent même surpasser les coûts des mesures de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Le chercheur regrette qu’ils soient trop peu évoqués dans le débat public.
- Carenews : Peut-on dire que dans la majorité des cas, les politiques de neutralité carbone ont des avantages pour la santé ?
Kévin Jean : Oui, dans la très grande majorité des cas. Dans une étude publiée en février dernier, nous avons essayé de synthétiser toutes les études scientifiques qui modélisaient les conséquences sur la santé de stratégies de neutralité carbone. 98 % de ces études documentaient des bénéfices pour la santé, sans que ce soient les objectifs principaux de ces politiques.
- Comment procède-t-on pour prévoir les bénéfices pour la santé de politiques climatiques ?
On se base sur les scénarios de neutralité carbone, des feuilles de route qui montrent comment on atteint la neutralité carbone à l’échelle d’un territoire, comme la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) en France. Ils décrivent toutes les transformations qu’on doit faire dans les principaux secteurs d’activité, avec des détails techniques. Par exemple, le nombre de kilomètres faits par personne, par année, par mode de transport.
On peut utiliser certaines de ces données pour modéliser des changements qui vont avoir un impact sur la santé. Par exemple, le recours au vélo et à la marche nécessite une activité physique. Il y a des liens très robustes et très nets dans les études épidémiologiques entre l’activité physique et la santé, le risque de décès par exemple. En modélisant le changement de comportement d’un Français ou d’une Française, on arrive à projeter des impacts sur la santé, en l’occurrence bénéfiques.
- Y a-t-il d'autres exemples de politiques climatiques favorables à la santé ?
Dans les scénarios de neutralité carbone, on a également des évolutions du cheptel bovin que l’on peut traduire en évolution de l’assiette alimentaire moyenne, avec le grammage moyen de viande rouge par assiette. Là aussi, on a des relations très nettes entre ce grammage et le risque de décès.
Dans le domaine de la pollution de l’air, on peut retranscrire l'évolution des grands secteurs d’activité comme l’industrie, le transport et l’agriculture, l’évolution de la concentration en polluants atmosphériques et faire le lien avec la santé.
La très grande majorité des scénarios de neutralité carbone sont favorables à la santé, mais certains le sont bien plus que d’autres »
- Les co-bénéfices sanitaires sont-ils systématiques ou dépendent-ils des politiques adoptées ?
On a des scénarios extrêmes qui risquent d’apporter plus de risques pour la santé que de bénéfices. Il y a une seule étude dans notre corpus dans ce cas, américaine, dans laquelle tout le secteur de la production d’électricité passe à la biomasse. La combustion produit des polluants : si on fait reposer tout le système électrique sur la biomasse, les problèmes en santé respiratoire seraient en augmentation.
Au-delà de ça, la très grande majorité des scénarios de neutralité carbone sont favorables à la santé, mais certains le sont bien plus que d’autres. Un exemple éloquent, ce sont les politiques de décarbonation des transports urbains. Électrifier le parc automobile, est bien du point de vue des émissions de CO2 et des polluants atmosphériques, mais passe à côté des bénéfices de santé, contrairement à la promotion des mobilités actives et collectives.
- Quels sont les bénéfices de santé ? Une réduction de la mortalité, mais aussi des maladies, une amélioration de la santé mentale ?
Par les gains en termes de pollution atmosphérique, d’activité physique ou de nutrition, on va réduire le nombre de maladies chroniques : les cancers respiratoires et digestifs, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2.
Il existe aussi certainement un lien avec certaines pathologies de santé mentale, entre l’activité physique et le risque de dépression par exemple.
- Les bénéfices économiques liés à ces bénéfices sanitaires pourraient être supérieurs au coût des actions environnementales ?
Dans notre évaluation, parmi les études qui menaient cette analyse coûts et bénéfices, la plupart montraient que quand on mettait les bénéfices de santé dans la balance, ils compensaient, voire ils excédaient les coûts de mise en œuvre des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les bénéfices de santé compensent, voire excèdent, les coûts de mise en œuvre des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. »
- Selon vous, les enjeux de santé répondent à des biais susceptibles de conduire à l’inaction. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Si on arrête d’émettre du CO2, il va falloir plusieurs décennies ou même siècles pour en voir les effets climatiques. Par contre, les gains de santé publique se mesurent à court terme : à l’échelle de quelques jours pour la qualité de l’air, de quelques mois ou années pour l’activité physique ou l’alimentation. En prenant en compte cette dimension, on se rend compte qu’avec des politiques climatiques, on gagne dans le présent et on se met en condition pour gagner dans le futur.
Deuxièmement, un des problèmes de l’action climatique, c’est qu’on ne ressentira pas les bénéfices si on n'a pas d’action globale : le CO2 n’a pas de frontière. Ce n’est pas du tout vrai concernant les bénéfices pour la santé. Ils profitent aux populations qui font des efforts peu importe ce que font les autres pays.
Les bénéfices pour la santé profitent aux populations qui font des efforts, peu importe ce que font les autres pays. »
- En retour, le changement climatique fait peser des menaces sur la santé des populations, avec des coûts associés. Quelles sont ces menaces ?
Il existe des effets très directs : l’augmentation de la température, de la pollution de l’air en raison de la transformation de la météo, du climat ou des feux de forêts. Il existe aussi des effets indirects, par exemple via les impacts du changement climatique sur la biodiversité avec les maladies infectieuses, la perte de rendement agricole. Il existe enfin des effets sanitaires via le fardeau que fait peser le changement climatique sur les infrastructures de santé : pendant un épisode de canicule, le nombre de passages aux urgences augmente et le système risque d’être saturé.
Ce que nous dit le Giec dans son dernier rapport, c’est qu’en 2020, ces risques pour la santé étaient observés dans toutes les régions du monde. Aucune région n’est à l’abri. Ils sont déjà là et documentés, ils pourraient devenir catastrophiques dans l’hypothèse d’un réchauffement à plus 3 ou plus 4 degrés.
Notre capacité d’adaptation face à ces risques connait des limites. En mettant des moyens, on peut s’adapter à un réchauffement climatique de l’ordre de plus 2 degrés, mais au-delà, on ne pourra pas s’adapter à tout. Il y aura des dégâts.
- La pandémie de covid 19 ou plus récemment la mobilisation liée au vote de la loi dite Duplomb ont illustré les liens entre climat et santé auprès du grand public. Trouvez-vous qu’on parle assez de ces liens ?
Je pense que non. On présente toujours le défi climatique comme un problème dans le futur, qui va toucher d’abord les autres régions du monde. On ne met pas assez en évidence le fait que ça nous touche dans nos corps, ici et maintenant. On ne fait pas toujours le lien entre santé et climat quand on vit des épisodes de canicule, par exemple.
Quant au fait que les politiques climatiques sont aussi des politiques de santé publique, c’est un lien qui n’est quasiment pas effectué et un message qui mériterait d’être plus diffusé.
On présente toujours le défi climatique comme un problème dans le futur, qui va toucher d’abord les autres régions du monde. On ne met pas assez en évidence le fait que ça nous touche dans nos corps, ici et maintenant. »
- Des politiques visant à limiter l’usage de la voiture, par exemple, ne semblent pas vraiment populaires. Insister sur leurs bénéfices de santé sera-t-il suffisant pour susciter l’adhésion ?
En prenant l’exemple de la voiture, je ne suis pas sûr qu’on arrive à rendre populaires des politiques d’interdiction sans promouvoir d’autres politiques de déplacement. Il y a vraiment un enjeu de prise en compte des populations qui sont affectées par les dispositions des politiques, comment compenser leurs effets, comment on partage l’effort collectivement. Je ne suis pas certain que le levier de la santé suffise à combler ce manquement.
On a beaucoup entendu que la politique des zones à faibles émissions [ZFE] était socialement injuste. C’est vrai d’un point de vue économique. Ce qu’on n'a pas beaucoup entendu, c’est qu’elle contribue à corriger les inégalités de santé. Très souvent, les politiques climatiques ont tendance à être socialement justes en termes de santé.
Très souvent, les politiques climatiques ont tendance à être socialement justes en termes de santé.»
- Les politiques publiques sur la biodiversité pourraient aussi avoir des effets positifs pour la santé. Y a-t-il des travaux à ce sujet ?
De manière générale, beaucoup de solutions sont gagnantes du point de vue de la biodiversité et du climat. En France et à l’échelle européenne, des études ont contribué à montrer que les politiques de changement de régime alimentaire, principalement d’assiettes moins carnées, sont très favorables du point de vue des émissions de gaz à effet de serre comme de la biodiversité. Et ce sont les assiettes les plus favorables à la santé.
Un autre exemple, ce sont les espaces verts urbains. Ils protègent du phénomène d’ilot de chaleur urbain, sont associés à des meilleurs états de santé avec la réduction de la pollution de l’air, l’incitation à l’activité physique, la réduction du bruit, l’amélioration de la santé mentale. Ils sont également favorables à la biodiversité en ville et permettent une meilleure gestion des précipitations.
Un dernier point, c’est l'alimentation biologique. On sait qu’utiliser moins de pesticides est la meilleure façon de réduire les pressions sur la biodiversité. Par ailleurs, de plus en plus d’études montrent le lien entre plus grande consommation d’aliments biologiques et des risques réduits de cancer et d’obésité.
À lire aussi : « Il faut prendre en compte l’inégale répartition des coûts de la transition écologique entre les citoyens » (Théodore Tallent, chercheur) 
Propos recueillis par Célia Szymczak