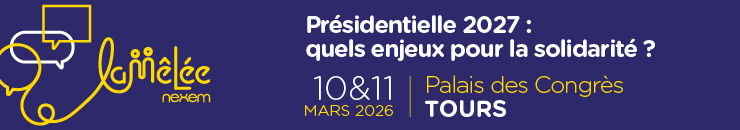Associations, fondations, bénévoles et philanthropes auprès des migrants
Chaque jour, des personnes migrantes, souvent venues d’Afrique, d’Iran, d’Afghanistan, franchissent les Alpes au terme de parcours éprouvants, parfois marqués par la faim, le froid ou la violence. Face à cette détresse, des ONG comme Médecins du monde ou la Cimade offrent un accueil vital : soins, repos et accompagnement humain. Pourtant, cette approche solidaire se heurte à une législation de plus en plus rigide. Le durcissement des lois migratoires fragilise davantage ces personnes déjà vulnérables, les exposant à l’errance, à la précarité et aux abus.

La Cimade, une histoire de la lutte contre les persécutions
-
Henri Masson, vous avez été jusqu’à récemment président de la Cimade, organisation historique de défense des personnes migrantes ou persécutées.
Henry Masson (HM) : Oui, j’ai été président pendant cinq ans, après six ans comme bénévole dans une permanence au nord de Paris. La Cimade, fondée pendant la guerre, dans les camps du centre de la France pour soutenir les antinazis puis les Juifs, a apporté un accompagnement spirituel et humain notamment en facilitant des passages vers la Suisse. Après la guerre, elle s’est engagée dans de nombreuses crises : Algérie, boat-people, réfugiés chiliens ou haïtiens. Aujourd’hui, ses 115 permanences en France accueillent 110 000 personnes par an pour les aider dans leurs démarches de régularisation.
Nous travaillons aussi avec des associations locales au Sénégal, en particulier pour défendre les droits des migrants en transit ou en départ, et soutenir ces structures face à des législations parfois hostiles.
Dans nos permanences nous traitons des sujets comme le droit au séjour, le droit d’asile ou le regroupement familial. Nous intervenons dans sept centres de rétention administrative (CRA). Il y en a un peu plus d’une vingtaine en France, et ce nombre augmente. Ces centres accueillent des personnes sans titre de séjour, arrêtées souvent sur la voie publique. Le préfet peut ordonner leur placement en CRA via une OQTF (obligation de quitter le territoire français). À côté de ces centres de rétention, il existe d'autres lieux de rétention administrative qui n'ont pas le statut de centre, mais qui peuvent jouer le rôle de centre pendant une période limitée. Nous sommes aussi présents dans les prisons où nous sommes la seule association officielle qui accompagne des personnes étrangères.
Nous faisons aussi de la sensibilisation, assurons des cours de français. Nous gérons un centre d'accueil de demandeurs d'asile et un centre d'hébergement pour des personnes ayant déjà obtenu l'asile pour les accompagner dans leur insertion dans la vie française.
Accompagner face à une complexité juridique en permanente évolution
-
Quel est le rôle de La Cimade dans ces centres ?
HM : Nous y avons des salariés, pas de bénévoles, qui accompagnent juridiquement les personnes pour contester leur rétention ou leur expulsion. Cela permet parfois leur libération. Environ 50 % des personnes enfermées sont libérées, certaines d’entre elles ne sont pas expulsables certaines ne peuvent l’être pour des raisons diplomatiques, d’autres ont des attaches en France ou ont été enfermées à tort.
-
Et que deviennent-elles après leur libération ?
HM : Elles restent sans statut. Nous les encourageons à se rapprocher de nos permanences pour explorer les possibilités de régularisation. Beaucoup ont déjà épuisé leurs recours en demande d’asile.
-
Cela signifie qu’elles restent dans un vide juridique ?
HM : C’est bien cela. Et ce vide peut durer longtemps. La durée maximale de rétention, aujourd’hui de 90 jours, pourra passer à 210 jours dans certaines circonstances suite à une récente loi. Une même personne peut enchaîner plusieurs séjours en CRA si elle est de nouveau arrêtée. Une autre proposition de loi prévoit même de remplacer les associations comme la nôtre par des agents de l’OFII pour cet accompagnement donc très administratif sans accès d’intervenants extérieurs.
-
Vous accompagnez aussi des réfugiés ayant un statut ?
HM : Oui. À Massy, nous avons un centre d’hébergement pour réfugiés statutaires et un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. On les aide dans leur insertion : emploi, logement, scolarisation des enfants, etc. Mais la majorité des personnes que nous accompagnons restent en attente de statut.
L’aide humanitaire inscrite dans la vocation de Médecins Du Monde
-
Christian Reboul vous êtes référent migration chez Médecins du Monde. Votre action semble différente de celle de la Cimade car vous allez directement au contact, notamment aux frontières ?
Christian Reboul (CR) : Oui, notre approche est un peu différente, mais nos combats se rejoignent souvent. Dans notre action nous parlons plutôt de personnes en grande précarité, dont une grande partie sont des personnes migrantes ou demandeuses d’asile. Dans de nombreux contextes, en France comme ailleurs, leur précarité justifie pleinement notre intervention.
-
Vous intervenez donc dès l’entrée sur le territoire ?
CR : Exactement. Nous nous intéressons aux parcours des personnes. Ainsi, nous sommes présents à la frontière franco-italienne, mais aussi dans plusieurs grandes villes comme Paris ou Marseille, où les exilés poursuivent leur chemin et sur le Nord littoral, auprès des personnes qui souhaitent se rendre en Grande-Bretagne. En France, nous avons 14 centres fixes de soins et d’orientation, et nous menons aussi des maraudes pour aller à la rencontre des personnes vivant dans des campements informels, des squats ou des bidonvilles.
Accueillir et suivre les migrants dès leur arrivée
-
Concrètement, que se passe-t-il à la frontière franco-italienne ?
CR : Les personnes arrivent après un long parcours, en provenance de la Corne de l’Afrique, d’Afrique francophone, d’Iran ou d’Afghanistan selon les périodes. Parcours éprouvant, elles et ils ont souvent dû traverser le Sahara, survivre à des violences en Libye, et traverser la Méditerranée, parfois secourus par des ONG comme SOS Méditerranée. Quand elles arrivent du côté italien des Alpes, elles doivent encore franchir le col de Montgenèvre, à 1850 mètres d’altitude, pour atteindre Briançon. C’est un passage dangereux, souvent en hiver, dans des conditions extrêmes : neige, gelures, blessures... Tout cela pour éviter les contrôles policiers. Et elles arrivent épuisées. Le lieu d’accueil, Les Terrasses solidaires, mise en place par la mobilisation citoyenne dans le Briançonnais joue alors un rôle crucial. C’est un lieu de répit, de repos, de premiers soins, d’abri temporaire, un sas de transition. Nous y tenons une permanence médicale en partenariat avec l’hôpital de Briançon.
-
Vous parlez de maraudes. En quoi consistent-elles exactement ?
CR : Nous avons une unité mobile de mise à l’abri : un véhicule de Médecins du Monde, avec des soignant.es à bord. Elles et ils assurent un premier examen médical, puis orientent les personnes vers l’hôpital de Briançon, les services d’urgence pour les cas extrêmes, ou plus souvent vers les Terrasses solidaires.
-
Une fois pris en charge sur le plan sanitaire, que deviennent les exilés ? Ils disparaissent dans la nature ?
CR : En général, beaucoup ont un projet assez clair. Briançon est une étape, les personnes restent 2 ou 3 jours aux Terrasses Solidaires, puis repartent vers Paris ou le Nord de la France, souvent pour tenter de se rendre en Grande-Bretagne.
Des contrôles renforcés facteur de risques pour les migrants
-
Les personnes peuvent-elles demander l’asile à la frontière ?
CR : Théoriquement oui. Jusqu’à récemment, et pendant quelques mois, le droit de demander l’asile était à nouveau respecté. Mais depuis octobre 2024, les pratiques ont radicalement changé. Les personnes sont souvent reconduites immédiatement en Italie, sans pouvoir déposer leur demande. Ce non-respect du droit pousse les exilés à éviter tout contact avec les forces de l’ordre, au prix de parcours de plus en plus risqués.
-
Et la police ? Elle ne les intercepte pas à la sortie ?
CR : Les moyens déployés à la frontière sont de plus en plus important : patrouilles dans la montagne, utilisation de drones. Récemment et pour la première une compagnie de CRS a été déployée. Mais les personnes finissent par passer. Il n’y a pas de contrôle systématique à l’hôpital ni aux Terrasses, qui restent des espaces à peu près sanctuarisés.
HM : Ils font un travail remarquable en particulier à Montgenèvre et Briançon. J’ai moi-même participé à une maraude avant 2024. Ce qui m’a marqué, c’est le dispositif policier très important, avec des moyens considérables déployés pour intercepter des personnes déjà très fragilisées. Certaines doivent fuir au risque de leur vie. Il y a parfois des accidents, voire des morts, même si heureusement cela reste rare.
La Cimade n’y est pas très présente et ce n’est pas un lieu où les personnes restent longtemps. Elles repartent vite, souvent vers Paris. Ce lieu est respecté et laissé tranquille par les autorités, ce qui permet d’éviter des tensions dans Briançon et de garantir aux exilés un minimum de dignité à ce moment de leur parcours. Beaucoup cherchent leur communauté, un accueil familial ou amical, parfois dans d’autres pays. La France n’est pas toujours leur destination souhaitée, mais ils s’adaptent au parcours. Et certains demandent l’asile faute d’alternative, pour accéder à un hébergement temporaire.
CR : À Dunkerque la situation est dramatique on compte actuellement 1 500 à 2 000 personnes vivant dans des campements sordides, avec seulement 19 robinets d’eau potable, aucun accès à des douches ou sanitaires. L'État est absent, tout repose sur les associations, comme Utopia 56 ou Médecins du Monde, qui déploie une clinique mobile pour les soins de base et l’orientation médicale.
HM : Avec le Secours Catholique et la Faculté Catholique de Lille par exemple, nous avons un bus d’accueil à Calais deux fois par semaine pour les aider à comprendre leurs droits et, éventuellement, entamer une demande d’asile.
La précarité juridique et sociale pour les demandeurs d’asile
-
Le statut de demandeur d’asile n’est pas le statut de réfugié, c’est temporaire ?
HM : Oui, il y a d’abord le statut de demandeur d’asile, qui peut aboutir à celui de réfugié.
-
Cela donne-t-il un droit au séjour, au travail ?
HM : Pas au travail tout de suite, et c’est problématique. On laisse des gens dans la précarité, alors qu’ils pourraient avoir une activité et bénéficier de ressources. Cela les expose à la survie par le vol, la drogue…
-
Et aux mafias, j’imagine notamment pour les femmes...
HM : Oui, et les femmes sont particulièrement vulnérables. Elles sont souvent mal orientées ou livrées à elles-mêmes. À Paris, nous avons une permanence dédiée aux violences faites aux femmes.
CR : Et rappelons que dans le monde une personne migrante sur deux est une femme et elles sont souvent moins visibles, invisibilisées. Elles sont tout autant actrices de leur parcours, pas seulement des « victimes ».
Une coordination pour être plus efficace pour veiller au droit
-
Vous avez lancé une coordination entre plusieurs associations pour agir aux frontières intérieures, c’est bien ça ?
CR : Oui, cette coordination existe depuis huit ans, entre Médecins du Monde, la Cimade, le Secours Catholique, Médecins Sans Frontières et Amnesty International. L’objectif est de veiller au respect du droit aux frontières intérieures de l’Union européenne.
-
Où intervenez-vous précisément ?
CR : Nous avons commencé sur la frontière franco-italienne, dite « basse » (Vintimille/Menton) puis élargi nos actions à à Montgenèvre/Briançon. Nous avons ensuite étendu à Modane en Savoie, et nous surveillons aussi d’autres points de passage sur une autre frontière intérieure : la frontière franco-espagnole.
-
Et concrètement, que faites-vous ?
CR : Nous réalisons des observations de terrain pour documenter les pratiques (refoulements, non-respect du droit d’asile, etc.), et nous interpellons les autorités : préfets, ministère de l’Intérieur, procureurs… Cela alimente aussi des actions en justice. Nous avons par exemple obtenu une meilleure reconnaissance du droit à la protection pour les mineurs isolés, qui sont désormais plus systématiquement pris en charge, notamment à Briançon – ce qui n’était pas le cas avant.
-
On parle surtout du Sud, les migrants ne passent ils jamais par le Nord ?
CR : C’est vrai que la majorité vient du Sud, via la Méditerranée ou les Balkans. Mais certains arrivent aussi par le Nord ou l’Est, après être passés par d’autres pays européens. Les routes sont multiples.
Un droit mal appliqué et inefficace
-
Henri, à la Cimade vous suivez de près l’évolution du droit. Où en est-on aujourd’hui ?
HM : Chaque ministre de l’Intérieur pense pouvoir « régler » la question migratoire avec une nouvelle loi. Résultat : on a empilé une quarantaine de lois depuis la guerre, toujours plus restrictives pour les personnes étrangères, sans résoudre les causes des migrations.
-
Pourtant, le cadre juridique semble structuré ?
HM : Oui, il y a une trame légale, mais elle se durcit sans cesse : durée de rétention allongée, délais de recours réduits, etc. Tout est fait pour dissuader, pas pour accueillir dignement.
-
Et le renvoi vers les pays d’origine ?
HM : C’est un échec. La France émet près de la moitié des OQTF d’Europe, mais seulement 5 % sont réellement exécutées. Beaucoup de personnes ne peuvent pas être renvoyées : leur pays ne les reconnaît pas ou refuse de les reprendre.
-
Ce sont donc des mesures d’affichage, inefficaces sur le fond ?
HM : Exactement. On investit dans des murs, des radars, on signe des accords avec l’Angleterre, mais on refuse de regarder les vraies causes : la guerre, la misère, la faim. Et maintenant, le climat aggrave encore les départs. Si on ne traite pas ces causes, la situation continuera à empirer.
-
Et on n’est pas prêt à les accueillir non plus, une fois arrivés…
HM : Non. Les personnes qui réussissent à arriver sont souvent mal accueillies, laissées dans la précarité, voire découragées de rester.
-
Christian, vous avez aussi un rôle de défense du droit ?
CR : Oui, une partie de notre action est de rappeler le droit aux autorités ! Nous sommes obligés de rappeler également que les politiques de santé ne se décident pas au ministère de l’Intérieur mais au ministère de la Santé et des Solidarité. En effet, on observe une ingérence toujours plus grande des considérations de politiques migratoires dans le champ du médico-social. Finalement, on essaie d’agir sur plusieurs politiques publiques qui contribuent à une politique d’accueil : l’accès aux soins bien sûr, mais aussi les politiques d’hébergement, le droit au séjour, qui sont autant de déterminants de la santé des personnes.
Porter un regard humain sur la migration
-
Henri, avez-vous réfléchi à une politique d’asile plus juste en France ?
HM : Nous défendons une vision ambitieuse et à long terme : celle de la liberté de circulation et d’installation pour toutes et tous. Cela peut sembler utopique, mais nous pensons qu’à l’heure du réchauffement climatique, des conflits, des inégalités économiques, et de l’interconnexion mondiale, il est fondamental de reconnaître ce droit comme un principe de justice et d’égalité. Aujourd’hui, seuls certains peuples peuvent circuler librement. Nous, Français avons cette liberté grâce à notre passeport. Mais la majorité des habitants de cette planète n’y ont pas accès. Or, si nous voulons vivre dans un monde juste, il faudra que cette liberté soit partagée.
À la Cimade, nous ne faisons pas seulement du cas par cas. Nous portons des contentieux collectifs devant les juridictions pour faire appliquer ou faire évoluer le droit. Ce que nous défendons, ce n’est pas seulement la régularisation de telle ou telle personne, c’est une vision politique fondée sur la fraternité, un principe inscrit dans notre devise républicaine.
Il est urgent de repenser notre accueil : mieux traiter les personnes déjà présentes sur notre territoire, mettre fin à la violence administrative, et enfin, porter une approche coopérative avec les pays d’origine et de transit. Il faut aussi cesser de traiter la migration uniquement sous l’angle sécuritaire, ce que fait le ministère de l’Intérieur. Une politique migratoire digne doit être interministérielle : santé, solidarités, affaires étrangères doivent aussi être parties prenantes.
CR : Nous partageons cette vision, elle repose sur des principes fondamentaux et des réalités que beaucoup de citoyens comprennent dès lors qu’ils sont en contact direct, avec des personnes migrantes. Il existe en France une majorité solidaire silencieuse.
HM : Il faut continuer de porter cette vision, même si elle demande du temps.
-
On retient que les associations sont porteuses d’une vision et de pratiques humanistes. Elles ont une volonté d’appliquer les droits, de garantir l’accès aux soins et de sortir de cette crispation collective. Mais ce n’est pas facile dans le contexte actuel alors que cela pourrait s’inscrire dans une politique plus apaisée et humaine. Merci pour cet échange.
Propos recueillis par Francis Charhon