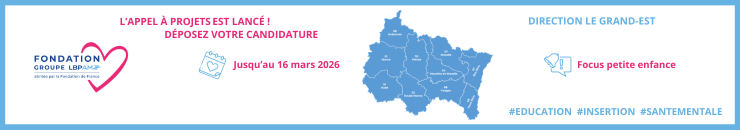[INTERVIEW] Yannick Blanc : « Les acteurs philanthropiques et associatifs doivent construire leur pertinence stratégique »
Une interview passionnante d’un haut-fonctionnaire engagé qui ouvre des pistes pour le futur du secteur de la philanthropie et des évolutions nécessaires de l’État. Un appel à une vision stratégique pour des changements indispensables à la société.

Un parcours de haut-fonctionnaire original et engagé pour la vie associative
- Yannick Blanc, vous êtes probablement l’un des hauts-fonctionnaires qui a le plus approché et connu le monde associatif à travers toutes les fonctions que vous avez exercées avant de quitter la fonction publique et de vous tourner vers les associations. Qu’est-ce qui a prévalu à ce chemin tout à fait original dans la fonction publique ?
C’est une affaire qui me poursuit depuis le début de ma carrière. Lorsque j’ai été au cabinet de Huguette Bouchardeau, ministre de l’Environnement, en 1984, donc deux ans après avoir commencé à travailler dans l’Administration, j’étais chargé à ce cabinet des relations avec les associations du monde de la protection de la nature et de l’environnement. Le ministère de l’Environnement et les associations étaient très différents il y a 40 ans de ce qu’ils sont aujourd’hui. Mais cela a été pour moi un premier contact intéressant et instructif et j’ai tout de suite eu d’assez grandes facilités de dialogue avec cet univers de personnes engagées, de militants. À cette époque les militants de la protection de la nature étaient beaucoup plus des naturalistes et des scientifiques engagés que des militants écologistes.
- Après cela, vous avez eu une succession de postes où vous avez évolué de façon très volontaire au contact des associations au ministère de l’Intérieur, dans des positions qui n’étaient pas très prisés…
Au ministère de l’Intérieur, ce n’était pas volontaire. En effet, lorsqu’après avoir fait l’ENA j’ai été affecté au ministère de l’Intérieur et après les premiers poste territoriaux où j’ai eu des relations avec le monde associatif, comme tous les sous-préfets et les personnels en poste dans les préfectures, j’ai passé deux ans à la Direction Générale de la Police nationale. Là, j’étais très loin du monde associatif, mais le jour du scandale de l’ARC, je passais dans le couloir du sous-directeur chargé des ressources humaines. Alors que j’étais venu le voir pour lui parler de mon prochain poste, en m’y prenant très à l’avance, il venait lui d’être « mandaté » par le cabinet du ministre pour trouver un jeune et nouveau chef du Bureau des associations. Ce scandale de l’ARC a causé à cette époque un choc considérable. L’ARC étant une Association Reconnue d’Utilité Publique, elle était théoriquement sous le contrôle du ministère de l’Intérieur et cela a naturellement entraîné beaucoup de remises en question. On m’a alors proposé ce poste que j’ai accepté tout de suite parce que c’était un défi, que l’on était dans une situation de crise et qu’il y avait tout à faire. J’ai tout de suite compris que l’on me demandait d’avoir de l’initiative et de prendre des responsabilités de manière relativement autonome du reste de l’Administration. Comme l’autonomie et le goût de la liberté est ma pente naturelle, j’ai accepté le poste sans beaucoup hésiter. Après quelques années à ce poste, je me suis fait une réputation à la fois de quelqu’un d’indépendant et de relativement marginal, et cela m’a poursuivi.
Une prise de conscience de la nécessité de structurer le secteur pour le fiabiliser
- Vous avez poursuivi cette trajectoire après le Bureau des associations au ministère de l’Intérieur, vous êtes allé au cabinet du ministre. On vous a vu pratiquement partout où il y avait des évolutions et des enjeux pour les associations, même si votre carrière vous a amené à d’autres postes.
Effectivement, pendant une dizaine d’années, j’ai été successivement chef du Bureau des associations puis au cabinet où j’ai eu d’autres responsabilités, mais j’avais demandé à garder un œil sur ce secteur et cela n’a pas été discuté. Ensuite j’ai été sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative, une sous-direction qui regroupait les élections, les associations et fondations et les cultes. Ainsi pendant dix ans j’ai été l’homme du ministère de l’Intérieur qui s’intéressait aux associations. Le scandale de l’ARC a soulevé les questions liées au plan comptable des organismes sans but lucratif et aux modalités de contrôle, et j’ai porté la montée en puissance des commissaires aux comptes. Ensuite, pendant que j’étais au cabinet il y a eu une politique active de la vie associative de la part du gouvernement Jospin avec les Assises nationales de la vie associative en 1999 et le centenaire de la Loi de 1901 en 2001, alors que j’étais devenu sous-directeur. J’étais encore sous-directeur au moment de la Loi Aillagon et bien que le ministère de l’Intérieur n’ait pas été le porteur de cette loi, j’ai été associé assez étroitement à l’équipe du ministère de la Culture qui a élaboré ce texte.
- À travers ce cheminement qui commence à une époque où les choses étaient encore balbutiantes et aujourd’hui, comment voyez-vous l’évolution de ce secteur ?
On peut considérer l’évolution du secteur à deux niveaux : il y a d’une part la trajectoire de professionnalisation des fonctions de gouvernance, d’administration, de gestion, de management des associations. L’ARC caricaturait toutes les faiblesses de la gouvernance associative à l’époque, c’est-à-dire des dirigeants cooptés, un conseil d’administration passif, des responsabilités qui n’étaient pas clairement établies, l’absence totale de procédures et la dérive d’une gouvernance charismatique transformée en système de détournement des ressources d’une association qui brassait d’énormes flux financiers. À ce moment-là, il y a eu dans le monde associatif, dans le monde de l’administration et dans les professions du chiffre pas mal de réflexion sur l’ensemble des réformes qu’il fallait mener à bien. Je voudrais rendre hommage à la mémoire de Michel Lucas, qui était l’Inspecteur général des Affaires sociales qui avait été le premier à lever le lièvre des modes de gestion de l’ARC et qui en a été le président après le scandale, au moment où il prenait sa retraite. Michel Lucas a vraiment été un haut-fonctionnaire complètement investi dans la tâche qui a consisté à ramener cette structure associative dans le droit chemin de l’intérêt général et à réfléchir de manière à la fois très politique et très technique à ce qu’il fallait faire pour y parvenir. Nous avons eu très souvent l’occasion de réfléchir et de travailler ensemble.
Ce qui a complètement changé entre cette époque et maintenant c’est la la façon dont on considère la fonction de trésorier dans les associations. Quand je suis arrivé dans le monde associatif il y avait énormément d’associations, y compris de très grandes associations, où l’on se débarrassait de la fonction de trésorier en la confiant à quelqu’un qui était censé connaître les techniques du chiffre et on évacuait cette question. Elle n’était pas au centre de la gouvernance. Lorsque j’ai été nommé, on m’a demandé de rendre effectif le pouvoir de contrôle dont le ministère de l’Intérieur jouissait sur les associations et Fondations Reconnues d’Utilité Publique (FRUP). Au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que le contrôle à partir de l’envoi des comptes annuels au ministère, qu’il a déjà fallu réamorcer parce qu’il était négligé, était impossible parce que les documents comptables que nous recevions étaient construits de manière complètement hétérogène et aucune comparaison n’était possible. Chaque expert-comptable interprétait ou « bidouillait », pardon pour l’expression, le plan comptable général pour l’adapter au fonctionnement d’une association et on n’avait pas accès aux informations de base. C’est donc à partir de là que j’ai commencé à réfléchir avec des professionnels du chiffre à la problématique du plan comptable et que j’ai obtenu début 1998 du cabinet de Lionel Jospin que l’adoption d’un plan comptable spécifique soit mise à l’ordre du jour. Voilà pour l’aspect le plus technique des choses, qui m’a beaucoup occupé. À partir de là et du procès de Jacques Crozemarie, s’est embrayée toute une mécanique de réflexion sur la responsabilité des dirigeants associatifs et c’est cela qui a entraîné le mouvement de professionnalisation des gouvernances et de formalisation des process d’établissement des comptes, de transparence, de vérification, etc…
Moderniser les fondations, une bataille inachevée
- Vous avez vu aussi à ce moment-là l’évolution des fondations, puisque vous avez travaillé en 1996 dans un groupe de travail au conseil d’État sur la modernisation des fondations en France.
Oui, tout à fait et c’est là que nous nous sommes rencontrés !
- Vous aviez donc aussi un pied dans les fondations. Vous aviez ainsi une vision globale de la société civile et de ce que l’on appelle la philanthropie aujourd’hui, associations et fondations.
Oui, la problématique sur les fondations était complètement différente à ce moment-là. Il y avait eu peu de temps auparavant, en 1987 la Loi sur les fondations et en 1990 la loi sur les fondations d’entreprise. Avec Jacques Rigaud, qui avait créé et présidait Admical, nous avons créé un groupe de travail sur l’actualisation du droit des fondations d’entreprise, De fil en aiguille, au moment du gouvernement Balladur, il y a eu une de ces réflexions cycliques dans la vie politico-administrative française sur comment rendre plus attractif le droit des fondations. Nous nous sommes en effet rencontrés dans un groupe de travail animé sous la responsabilité du Conseil d’État. À ce moment-là, le climat était à une réflexion critique et à une volonté de faire évoluer, de faire avancer le fonctionnement, le droit, les procédures, l’idée que l’on se faisait du monde des fondations et ce contexte qui a créé l’ambiance de travail et de réflexion commune que nous avons eue ensuite pendant les années qui ont suivi.
- Peut-on dire qu’à partir de la Loi Aillagon en 2003, on est entré dans une nouvelle ère, avec en même temps la modernisation, la professionnalisation, et un peu de reconnaissance, mais pas trop ?
Oui, incontestablement, il y eu changement d’échelle, le mouvement de création de fondations s’est accéléré. La loi Aillagon a créé un vrai changement de climat grâce au régime fiscal qu’elle a instauré. La création du Centre Français des Fondations a également joué un rôle important dans la montée en compétence collective de ce milieu sur ses besoins, ses problématiques, ses horizons stratégiques, etc. Cependant, j’estime qu’il reste une moitié du chemin que nous n’avons toujours pas accomplie parce qu’il y a toujours eu une très forte inertie et une certaine incapacité intellectuelle de l’administration, et encore plus des politiques, à se saisir de la question des fondations avec une vue d’ensemble et une volonté réelle de rendre le système plus réactif, plus performant. Vous le savez, on continue à vivre aujourd’hui avec six ou huit régimes de fondation différents et malgré mes tentatives répétées au cours des années, je n’ai jamais réussi à obtenir que l’on s’attaque sérieusement à la modernisation de la reconnaissance d’utilité publique, qui est un système totalement obsolète, qui qui continue à vivre sur des fondements qui sont ceux de l’époque de la Restauration. La raison pour laquelle le Conseil d’État est en charge de la régulation des fondations est une cause historique qui date d’il y a deux siècles et qui n’a plus rien à voir avec ce que sont aujourd’hui les besoins des fondations, les besoins de contrôle. On a confié la régulation du monde des fondations à des personnes qui n’ont aucune compétence pour le faire. Comme les gens du Conseil d’État sont assez brillants, certains d’entre eux s’en sortent très bien, et nous avons avec certains d’entre eux réussi à faire des avancées significatives. Je pense notamment au travail que j’ai mené avec Bruno Genevoix, président de la Section de l’Intérieur à l’époque de la Loi Aillagon pour moderniser les statuts-types. Mais tout ce travail de modernisation a été entièrement effacé quelques années plus tard par Maryvonne de Saint-Pulgent qui a restauré, au sens historique du mot, une conception de la fondation comme expropriation du fondateur et mise sous tutelle de l’administration de l’acte de fondation. Sur ce point je pense qu’il y a encore une partie essentielle du chemin à accomplir.
Refonder le modèle social
- Depuis des années, le secteur philanthropique, associations, fondations, bénévoles et donateurs, n’arrive pas à trouver sa place dans les politiques publiques. Comment voyez-vous l’avenir ? Que faudrait-il faire pour que ce secteur prenne plus de place dans l’espace public et soit un véritable relais de l’État dans ce qu’il ne peut pas faire aujourd’hui, c’est-à-dire agir auprès des citoyens qui sont le plus en difficulté et qui se perçoivent comme abandonnés ?
Il y a pas mal de points communs entre le secteur des fondations et le secteur des associations. Elles sont à la fois très présentes dans un certain nombre de secteurs de politique publique, notamment le secteur social et médico-social. Il y a d’énormes fondations qui gèrent des réseaux d’établissements médico-sociaux et d’hôpitaux. Pourtant, il y a une incapacité permanente du monde politico-administratif à concevoir une politique globale du secteur de la philanthropie. C’est encore très caricatural dans le cas du secteur associatif ; comme il pèse plus lourd politiquement et qu’il touche beaucoup de monde, on voit régulièrement le Gouvernement, le Premier ministre réunir tout le monde, organiser des assises, annoncer un programme, faire des promesses… Tout cela est très rapidement dissipé, oublié et ne donne pas beaucoup de résultats. Dans le monde de la philanthropie, il y a eu un moment-clé après la Loi Aillagon avec la création des fonds de dotation. Là, il y avait une petite équipe de personnes au cabinet du Premier ministre qui étaient décidées à faire une percée dans le système, ce qu’ils ont réussi à faire en partie, il faut bien le dire. Mais cette manœuvre de corsaire n’a pas permis de créer une vision d’ensemble et une cohérence de la politique de la philanthropie. L’Administration en est incapable ou y est réticente parce qu’au fond se sont succédés aux postes de commandement de l’État les gens d’une génération qui avaient une vision très administrative, tutélaire, et qui considéraient que les acteurs privés devaient être vraiment en position subalterne. C’est la philosophie défendue par Madame de Saint-Pulgent au Conseil d’État. La génération suivante a été celle des gens qui ne juraient que par le monde de l’entreprise, du business et de la finance et qui considéraient que la philanthropie, le monde associatif était par rapport à cet univers-là étaient également subalternes.
Mais nous avons à la chance de vivre un moment de crise de ces deux modèles. À l’évidence, le modèle administratif, le modèle institutionnel subit une obsolescence de long terme, il est arrivé à sa limite. Plus personne n’imagine, même chez ceux qui défendent le service public et espèrent un jour lui redonner ses lettres de noblesse, ou même tout simplement le réparer, reconstituer le modèle administratif d’autrefois. Le modèle d’organisation, de gouvernance, de structuration, de mode fonctionnement est mort. Il bouge encore et pèse encore assez lourd, mais il a perdu sa vitalité et il est sur le chemin d’un déclin irréversible. Le modèle entrepreneurial et financier qui a été le modèle hégémonique des trente dernières années est dans le mur de la crise climatique, de la crise écologique. On sent bien tout ce monde chercher de nouveaux fondements de légitimité. Le Boston Consulting Group qui, au début des années 1980, a formalisé l’idée que toute la valeur devait aller à l’actionnaire, publie quarante ans après une note de doctrine disant que cette époque est terminée, qu’il faut reformuler ce que nous entendons par la valeur et trouver des formules de partage de la valeur entre les parties prenantes. Même si ce n’est que de la gesticulation, on sent bien que dans les esprits, dans la conception de la logique économique, quelque chose est en train de bouger. Actuellement, on voit un mouvement brownien avec des entreprises à mission, la RSE sous toutes ses formes, le Global Compact pour les objectifs de développement durable, etc. Toute la question de la place de l’acteur économique et de l’intérêt général se pose dans des termes nouveaux. Les réponses apportées à ces questions sont pour l’instant très insuffisantes, soit parce qu’elles sont purement hypocrites, sacrifient à la mode du « greenwashing »,... Par exemple avec la politique de BlackRock dont le patron, il y a deux ans, envoie une lettre à tous les chefs d’entreprises sur lesquelles il a investi et il écrit : « À partir de maintenant, nous n’investirons plus que dans les entreprises qui auront une stratégie de long terme de développement durable. » Deux ans après, BlackRock est pris la main dans le sac, car il garde une partie énorme de ses investissements dans les énergies fossiles. Nous sommes dans un moment de fragilisation de la légitimité de l’ensemble de ce système, mais pas de solution, pas de réponse pertinente aux questions écologiques et sociales qui lui sont posées, y compris par ses propres salariés et par certains de ses actionnaires.
Dans ce moment d’affaiblissement des deux modèles d’action collective, le modèle porté par la philanthropie et par les associations a une fenêtre. Ma vision est que ces acteurs doivent monter en compétence en termes de stratégie pour pouvoir profiter de cette fenêtre et obtenir un certain nombre de résultats. On le voit bien dans le monde philanthropique américain qui, comme vous le savez très bien, se déploie à une échelle totalement différente de la nôtre, où ces questions se posent régulièrement. Aujourd’hui la question présente dans toutes les publications, les colloques, les innombrables rencontres qu’organise le réseau philanthropique américain des fondations, des community fundations, est la recherche des leviers qui permettent d’obtenir un changement systémique. Ce sujet est donc posé dans le monde de la philanthropie à l’échelle mondiale et l’on voit bien qu’il commence à percoler dans le microcosme français de la philanthropie.
- En ce moment, il y a des discussions dans l’Union européenne sur l’économie sociale et solidaire qui est regardée comme un nouveau modèle, mais d’un point de vue strictement économique. On n’arrive pas encore à imposer l’idée qu’il existe dans cette économie sociale et solidaire un secteur non lucratif qui crée de la valeur sociale. Comment imposer cette idée et la transformer en stratégie du secteur ?
L’idée est profondément disruptive. Depuis la deuxième guerre mondiale, pratiquement toute l’action collective est construite dans les instances nationales et internationales sur l’idée que l’économie décide de tout. Cela a d’abord été dans sa version keynésienne, ensuite dans sa version néo-libérale. Les compétences, les constructions politiques, les projets politiques, la planification et la prospective sont basées sur l’idée que l’économie est le moteur de la société. C’est cette idée-là qui est en train de passer parce que la prise de conscience de notre incapacité collective à très grande échelle à tirer les conséquences de la crise climatique bouleverse la hiérarchie des valeurs. Il y a des ressources non économiques qui sont plus importantes que les ressources économiques, il y a des ressources qui ont été traitées jusqu’à maintenant comme des « externalités », les énergies fossiles, les ressources naturelles et aussi les ressources humaines dont on s’aperçoit qu’elles sont sur le point de disparaître. Ceci est un basculement majeur dans la conscience collective.
Au point où nous en sommes, nous avons évidemment beaucoup de mal à reconstruire les fondements intellectuels qui permettraient de considérer ces ressources à leur juste valeur, non pas juste du point de vue de la quantité, mais du point de vue de leur nature même. Il y a beaucoup de travaux sur ce sujet en ce moment, mais la percée n’est pas encore faite. Nous nous situons au moment où l’on a cru que ces questions de changement d’échelle de valeur étaient des questions de prospective de long terme alors qu’elles sont en train de devenir des urgences.
Pour une évolution de la stratégie du secteur de la philanthropie
- Vous avez indiqué que pour faire valoir le rôle des acteurs de la philanthropie dans l’espace public, il fallait une vraie évolution stratégique. Qu’entendez-vous par là ? Il faut refonder le modèle, refonder le discours ?
Il faut que ces acteurs tiennent un discours stratégique. Il faut que bon nombre d’entre eux cessent de se contenter d’un discours de justification sur ce qu’ils font, même si la justification est légitime, et parfaitement recevable. Les arguments sont : « ce que je fais est bien parce que j’aide des gens formidables… , parce que je viens au secours ou à l’aide de populations qui en ont besoin ». Ce plaidoyer de l’utilité sociale n’est pas en lui-même contestable, mais il faut changer de registre et il faut passer du plaidoyer d’utilité sociale à la vision stratégique. Compte tenu de la nature, de l’ampleur d’un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous collectivement acteurs de la philanthropie, nous collectivement acteurs de l’ESS ou du monde associatif, devons mettre en avant le type de ressources que nous pouvons mobiliser, le type d’action que nous pouvons mettre en œuvre et les services que nous pouvons rendre à la société aux côtés des acteurs économiques ou politiques. Là, nous sommes encore trop en arrière de la main.
- Ce secteur ne devrait-il pas être reconnu comme un secteur social à part entière comme l‘industrie, l’artisanat ou l’agriculture par exemple, pour que s’instaure un dialogue structuré avec l’État ? À lui de son côté de mettre en place la structuration qui permet le dialogue.
Sur ce point-là, je constate que ces acteurs, je pense autant au monde associatif qu’au monde de la philanthropie, tiennent depuis très longtemps un discours de revendication et d’attente d’une reconnaissance de la part des pouvoir publics, de l’État. Il faut changer de discours, il faut qu’ils construisent leur pertinence stratégique, qu’ils la négocient et qu’ils l’imposent à leurs interlocuteurs. Dans les circonstances d’aujourd’hui, ce sont des acteurs qui sont autoporteurs. Ils n’ont pas besoin qu’on leur octroie une légitimité, puisque leur légitimité, ils la tiennent de leur capacité d’action. Et il y a un certain nombre de questions, de thèmes, d’enjeux de circonstance dans lesquels leur capacité d’action est supérieure à celle des acteurs publics.
Les acteurs publics ne peuvent plus se passer d’eux, comme le montre l’exemple remarquable de ce que l’on appelle les cités éducatives, ce dispositif de coopération entre les établissements scolaires et les autres acteurs du parcours éducatif des enfants et des jeunes. Ce projet, initialement conçu par Jean-Louis Borloo, a été lancé en 2019 par Jean-Michel Blanquer. Chacun sait que celui-ci est loin d’être le ministre le plus ouvert sur la société civile qu’on ait eu à l’Éducation nationale, mais même lui s’est rendu compte que l’on ne pouvait pas faire autrement. Pourtant un acteur comme celui-là, hyper-jacobin, hyper-centralisateur, hyper-vertical, reconnaît que dans les quartiers de la politique de la ville on ne luttera pas contre l’échec scolaire si on ne mobilise pas les acteurs qui sont autour de la communauté éducative. C’est un basculement, c’est un changement de modèle, qui ne parvient portant pas à s’installer, parce que l’Administration n’a pas les outils intellectuels, méthodologiques pour le faire avancer. Le besoin de coopération avec les acteurs de la société civile porte aussi sur les modes d’organisation et d’action. C’est là une fenêtre dans laquelle il faut s’engouffrer de manière très volontariste et très stratégique.
Un État qui doit évoluer pour s’adapter aux réalités actuelles
- Pour quelqu’un qui a été dans l’Administration et qui en connaît les moindres coins et recoins, la question qui se pose n’est-elle pas maintenant une bataille existentielle, une sorte de bataille d’arrière-garde, car elle remettrait en cause la légitimité de l’État ? Peut-il reconsidérer son rôle comme un ensemblier plutôt que comme un fabricant de normes, de dispositifs que plus personne ne peut appliquer? Je ne demande donc pas si l’État est légitime, je demande si le fait de reconnaitre un certain nombre de faits et d’actions complémentaires par les acteurs de la philanthropie ne fait pas abandonner aux fonctionnaires, quelque chose qu’il ne veulent pas perdre ?
Je ne le crois pas. Il y a deux choses qui caractérisent la situation de l’État aujourd’hui : d’une part, et on l’a bien aperçu à l’occasion des crises que nous avons traversées, c’est que sa légitimité de fond, sa nécessité n’est pas remise en cause. En revanche, sa façon de faire est totalement déconnectée. D’autre part, les politiques de rationalisation bureaucratique menées depuis 20 ans ont privé l’État d’un très grand nombre de compétences dont il avait besoin, et le scandale Mac Kinsey en est un révélateur. Quand on n’a plus les compétences en interne, on va les chercher en externe, selon des modalités avec des critères de performance qui ne sont pas les bons. Cela donne donc des résultats qui ne sont toujours excellents.
L’État a totalement négligé au cours des dernières décennies le renouvellement de ses savoir-faire. La formation des hauts-fonctionnaires, et d’ailleurs des moins hauts, a été entièrement déterminée par la rationalisation sur des critères budgétaires, qui est une forme de rationalisation bureaucratique moderne. Pendant ce temps-là on n’a pas vu, ou on n’a pas tiré toutes les conséquences des transformations qui étaient en train de se produire dans la société, dans le monde de l’économie qui appelaient d’autres formes d’interventions collectives. Aujourd’hui, on a besoin de l’État sous trois angles. L’État ne répond aux besoins émergeants que par de nouvelles normes. À la façon du Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, on entend les politiques tonner tous les matins contre la surabondance de normes, exiger de la simplification et réclamer tous les après-midis une « grande loi » pour traiter tel ou tel problème. On ne sortira de ce paradoxe que si on comprend qu’il y a trois fonctions où l’on attend de l’État qu’il transforme ses métiers, de ses structures, de ses façons d’agir.
- On a d’abord besoin d’un État investisseur. Les programmes d’investissement d’avenir, le Commissariat Général à l’Investissement est une bonne maquette de cela. On sait que dans nombre de domaines décisifs, l’investissement privé n’existe pas s’il n’y a pas une base d’investissement public. Tout cela a été largement documenté et développé dans des études sur la façon dont s’est développé l’internet aux États-Unis, par le rôle des investissements militaires, etc. Le Programme des investissements d’avenir montre qu’y compris au sommet de l’État, on a pris conscience de cela et que si l’on veut se mettre au niveau dans le domaine des batteries, des énergies renouvelables, des biotechnologies, etc., il faut des programmes d’investissement public. Un État qui se comporte en investisseur, ce ne sont pas les mêmes procédures, pas les mêmes process, pas les mêmes métiers, pas les mêmes réflexes qu’un État bureaucratique qui administre une société.
- Nous avons besoin d’un État régulateur, capable de mener une « politique de régulation ». C’est-à-dire qu’au lieu d’empiler les normes, au lieu de faire de l’excès de zèle sur l’application des normes européennes, on développe une intelligence normative, une intelligence de l’interprétation de la mise en œuvre des normes, on construit une stratégie d’utilisation des normes. Il y a des tas de milieux industriels où l’on sait très bien structurer une politique normative pour atteindre des objectifs économiques et industriels. On peut aussi le faire pour atteindre des objectifs d’intérêt général. Nous vivons dans un univers normatif d’une très grande complexité, où les sources normatives se sont multipliées, alors que nos doctrines de droit public, nos doctrines institutionnelles… continuent à faire comme si le monde juridique était une pyramide avec une seule norme fondamentale dont découlait toutes les autres. On vit maintenant dans un écosystème de normes nationales et internationales, éthiques, techniques, géopolitiques…, et l’on a besoin de construire un savoir-faire stratégique dans cet univers. Cela n’existe absolument pas aujourd’hui dans la formation des hauts-fonctionnaires ni dans la façon dont les politiques raisonnent en termes de normes.
- Il faut un État intégrateur que j’appelle de mes vœux depuis des années. L’équipe de France Stratégie vient de trouver dans l’excellent rapport sur les soutenabilités qui vient de sortir et qu’il faut absolument lire, une formule beaucoup plus éclairante. C’est vraiment l’un des documents les plus passionnants que j’ai lu depuis de longues années. Elle parle d’un État « orchestrateur », au sens propre du terme. L’orchestrateur, ce n’est pas celui qui écrit la partition, ce n’est pas celui qui joue de l’instrument, mais c’est celui qui fait que quand l’orchestre joue ensemble, le résultat est audible. On a besoin de cela. L’État orchestrateur c’est sortir du mythe de l’État stratège qui concentre l’intelligence, la matière grise, la compétence, l’expertise, qui la met en œuvre et ensuite le reste de la société n’a plus qu’à exécuter le plan conçu par l’état-major.
- C’est l’époque du Plan.
C’est l’époque du Plan électronucléaire français, chacun voit bien qu’on ne peut tout simplement plus gouverner de cette manière. Nous vivons dans un univers où il y a une multiplicité de stratèges qui sont de bons stratèges, des stratèges économiques et des stratèges sociaux, des stratèges territoriaux, des petits et des grands. Le rôle de l’État n’est pas de soumettre ces stratégies à une grande stratégie, il est d’orchestrer la multiplicité des petites stratégies dont certaines ne sont pas très intéressantes parce qu’elles sont la poursuite pure et simple du profit. Quand l’industrie numérique développe le porno, c’est une stratégie qui n’a pas besoin d’être soutenue ni encouragée, bien qu’elle contribue au Produit Intérieur Brut. Par contre, il y a de petits stratèges, parmi eux évidemment les acteurs de l’intérêt général, associations et fondations, mais aussi des acteurs économiques, des entreprises qui sont capables de contribuer au bien commun. Mais ils ont besoin d’un orchestrateur pour que leur petite partition, leur petit solo de batterie ou de clarinette puisse s’intégrer à un ensemble plus grand. Cette technique de gouvernement est encore à construire. Elle réclame de la part des administrations, des fonctionnaires, des décideurs du monde public, une beaucoup plus grande intelligence dans les capacités de coopération avec les autres acteurs que sont d’une part les acteurs économiques et d’autre part les acteurs de l’intérêt général de la philanthropie et des associations.
- C’est une forme d’adaptabilité, de flexibilité et une forme de travail, en réseau, en collectif. L’État partenaire, est-ce un rêve ?
Non, pas tout à fait, nous disposons de nombreuses expériences qui montrent que l’on est capable de le faire, avec les territoires zéro chômeur, les pôles de compétitivité… Il y a des dispositifs sectoriels partiels, limités, qui ont montré que dans les différents univers professionnels les gens étaient prêts à cette façon d’agir mais on n’a pas tiré de ces expériences les conséquences sur l’ensemble de la machine.
- Cette stratégie que vous évoquez passe beaucoup en ce moment par quelque chose qui est très reconnu : soutenir les startups, soutenir l’agriculture… Mais toujours avec un angle mort sur le secteur des associations et des fondations qui ne sont pas reconnues comme un acteur essentiel de la société aujourd’hui, à mon avis.
Comme les secteurs dans lesquels ces acteurs évoluent sont en train de connaître de véritables phénomènes d’effondrement, la santé, le social, l’éducation et même la culture dans certains domaines, le modèle administratif traditionnel n’est pas en mesure de répondre à la situation. Tout le monde sait que nous devons reconstruire notre système de santé publique en sortant du système hospitalo-centré, en inventant une santé de proximité qui ne repose pas uniquement sur le médecin généraliste, en intégrant la prévention à son juste niveau dans les stratégies de santé publique… Tout le monde le sait, les experts ne sont pas en désaccord sur ces questions, ce qui manque c’est la capacité politico-administrative à orchestrer ce changement de modèle, mais on ne peut plus y couper parce que l’on voit bien que le système sanitaire ne fonctionne plus du tout. En clair, le système ne peut plus soigner correctement.
Les modèles émergents de production de santé sont tous des modèles qui impliquent la participation d’acteurs volontaires, d’acteurs de l’intérêt général. Il n’y a pas un seul exemple à l’étranger de système de santé fonctionnant mieux que le nôtre ou étant en voie de transformation qui ne repose pas pour une part sur la constitution de secteurs volontaires philanthropiques, associatifs, citoyens, etc.
- On peut éviter Korian…
Korian eux-mêmes s’interrogent sur la transformation de leur mode de fonctionnement.
Faire de la prospective à partir des modèles existants
- En matière de prospective, vous avez parlé de vision stratégique, de changement de modèle, voudriez-vous compléter votre propos ?
La vision prospective est dans la prise de conscience de l’ampleur de la rupture qui est en train de se produire. On n’a pas besoin d’utopie pour imaginer l’avenir, on doit principalement prendre conscience de l’ampleur des transformations à opérer pour faire face aux besoins immédiats.
- Comme vous le savez, je suis un fervent militant de la philanthropie depuis de nombreuses années et je suis convaincu qu’il faut que nous continuions à avancer sur une stratégie commune, mais qu’est-ce qui peut être le facteur déclencheur au niveau de l’État ? J’ai beaucoup fréquenté les antichambres, je suis allé chez Emmanuel Macron, chez François Hollande, les directeurs de cabinet, les parlementaires, et on a l’impression que le message ne passe pas. On parle à des personnes qui vous reçoivent sympathiquement, mais rien ne bouge. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils avoir la capacité de changer cela ?
Ma réponse, c’est qu’il faut le leur imposer là où les acteurs associatifs et philanthropique sont capables de mettre sur la table des solutions opérationnelles expérimentées et dont la preuve de concept est faite. C’est là que se trouve le besoin d’organisation collective et stratégique du secteur. Il ne s’agit pas comme le font trop les organes représentatifs comme le Mouvement Associatif, le CFF... de défendre le modèle institutionnel en tant que tel. Il faut que les acteurs, avec les compétences dont ils disposent, l’expertise qu’ils ont accumulée, les expériences qu’ils ont faites, fassent masse de tout cela et s’adressent à l’acteur public qui est en situation d’impuissance aujourd’hui pour lui dire : voilà la partie de la solution dont vous avez besoin et pour que nous, nous puissions contribuer à cette solution, voilà notre besoin en termes de régulations, de normes, de procédures, etc. Il faut subordonner la question de la normativité aux objectifs stratégiques. C’est la grande rupture qu’il faut opérer dans l’action collective. Les acteurs de l’ESS et de la philanthropie ont compris cela, ils sont en train de le faire et les acteurs publics sont en mesure de le comprendre.
Tout le travail que je pilote avec la Fonda et maintenant l’Institut français du monde associatif sur la création de valeur cherche à constituer l’outillage intellectuel pour leur permettre de faire cela. Cela passe par de la recherche et de l’expérimentation, mais cela peut aller relativement vite.