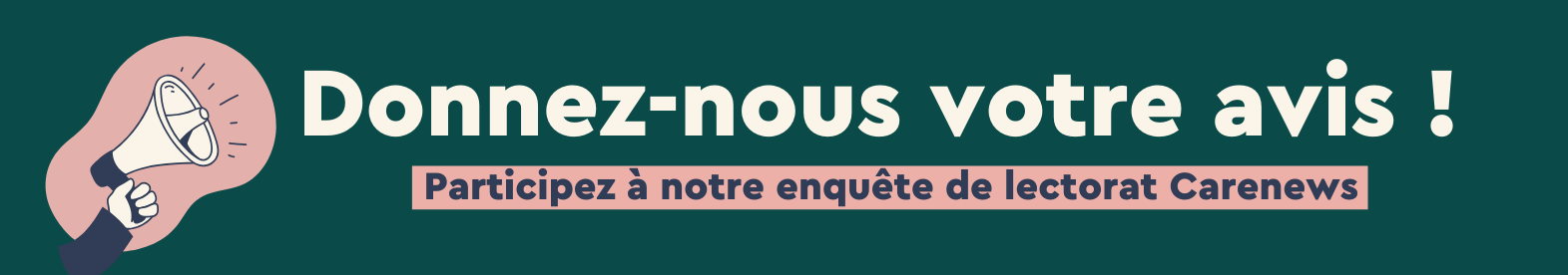Des dynamiques « insoutenables » : quel est l’impact environnemental réel de l’IA ?
Le développement de l'intelligence artificielle est énergivore, avec des conséquences sur le plan environnemental mettant potentiellement à mal la transition écologique. Il doit être régulé, pour Data for good et le Shift project.

Chaque semaine, ChatGPT compte 700 millions d’utilisateurs, selon OpenAI. Les usages ne sont pas seulement personnels : en 2024, 10 % des entreprises implantées en France utilisaient au moins une technologie d’intelligence artificielle (*), contre 6 % l’année précédente, d’après l’Insee. 40 % des grandes entreprises utilisaient l'IA en 2024 dans les pays de l’OCDE, indique l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
L’IA s’apparente à « une formidable révolution technologique et scientifique pour le progrès et au service du progrès », affirmait le président Emmanuel Macron en février dernier, lors du Sommet pour l’action sur l’IA organisé à Paris. Il s’est félicité des 109 milliards d’euros d’investissement privés en France « confirmés » à cette occasion.
L’industrie liée à l’IA représente désormais « des milliers de milliards de dollars de capitalisation boursière et de capital-risque », souligne l’AIE. « Jamais une fonctionnalité n’aura autant été poussée en si peu de temps, spatialement, graphiquement, interactivement et de manière autant répétée dans nos sites web, services et logiciels », estime l'ONG Limites numériques dans une publication.
Une utilisation massive de l’IA générative
Mais cet engouement à grande échelle est-il compatible avec le maintien du réchauffement climatique en deçà de deux degrés par rapport à l’ère pré-industrielle et le respect de limites planétaires ? Il existe peu de chiffres rendus publics par des fournisseurs d’IA, et que les données changent d’un modèle et d’une requête à l’autre. Cependant, « on dispose d’estimations : une requête ChatGPT aurait un impact dix à soixante fois plus important qu’une recherche Google », indique Dejan Glavas, professeur associé et responsable de l’Institut « AI for sustainability » à l’école de commerce Essca.
Fin décembre 2024, OpenAI faisait état d’un milliard de messages envoyés à ChatGPT par jour. Plus d’un milliard de requêtes à l’impact « anodin à l’unité » commencent donc à avoir un effet majeur, pointe Dejan Glavas.
Le rôle des data centers dans les émissions
De façon générale, les émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique augmentent d’une manière « incompatible avec sa décarbonation », soutient le Shift project (**), un think tank travaillant sur la décarbonation de l’économie, dans un rapport publié début octobre. En particulier, « les déploiements à large échelle de l’IA et de sa composante générative aggravent ces dynamiques déjà insoutenables », préviennent les auteurs. Le progrès technologique et les gains d’efficacité ne suffisent pas à compenser l’impact. À l’échelle mondiale, le Shift project prévoit une augmentation de 9 % par an des émissions du secteur à l’horizon 2030.
Concrètement, l’utilisation de l’IA nécessite des équipements comme des smartphones ou des ordinateurs, des réseaux pour échanger les informations et des serveurs afin de stocker et traiter les données. Ceux-ci se trouvent dans des centres dédiés, les fameux « data centers ». C’est à ces centres que s’intéresse le Shift project dans son rapport, puisque selon les auteurs, les impacts climatiques du numérique sont plus quantifiables dans ce cas que pour les équipements et les réseaux.
Les déploiements à large échelle de l’IA et de sa composante générative aggravent ces dynamiques déjà insoutenables »
Une relance des fossiles ?
Un quart de l’empreinte carbone des centres de données s’explique par leur construction, explique le think tank. Le reste provient de leur usage. La consommation d’électricité associée, « tirée par l’IA » et « tout particulièrement l’IA générative », croît et devrait être multipliée par 2,3 à 2,7 à l’horizon 2030 à l'échelle mondiale « sans évolution majeure des dynamiques actuelles ».
Or, elle a déjà un impact climatique important : aux États-Unis par exemple, « la réponse immédiate à la hausse de la demande énergétique passe par une relance massive des infrastructures fossiles », selon le Shift project. En Irlande, pays « qui s’est positionné comme l’un des leaders européens du secteur numérique », l’opérateur national du réseau d’électrique a mis en place un moratoire sur les nouvelles demandes d’implantation de centre de données jusqu’en 2028, en raison de la croissance de la demande d’électricité. « Pour continuer d’assurer leur développement, les centres de données se sont tournés vers des alimentations au gaz naturel », donc vers le fossile.
Risque de concurrence et de pénurie
A l'échelle européenne, faute d’intégration de la croissance de la consommation électrique liée aux centres de données dans les scénarios de planification énergétique, l’électricité décarbonée pourrait manquer. L’augmentation de la consommation pourrait ainsi « [hypothéquer] la capacité de l’Europe à atteindre ses objectifs climatiques » d'ici à 2035, insistent les auteurs.
De plus, en France à l’horizon 2035, suivant les « dynamiques actuelles », il pourrait exister une concurrence pour l’usage de l’électricité entre les centres de données et d’autres filières, dans les secteurs « dont la décarbonation complète ne peut passer que par leur électrification », comme l’industrie ou les transports, alertent-ils encore.
Au-delà des questions énergétiques, l’entraînement et l’utilisation de l’IA requièrent l’extraction de matières premières, notamment de métaux, mais aussi un prélèvement d’eau, en particulier pour les systèmes de refroidissement des centres de données. Dans les zones arides, cela peut « mener à des risques de concurrence avec les consommateurs, les hôpitaux, les industriels, et donc de pénurie », prévient Dejan Glavas. Un élément important, alors que les sécheresses et les périodes de fortes chaleurs vont s’aggraver avec le changement climatique et que la localisation des centres de données est souvent concentrée géographiquement. Enfin, construire ces infrastructures contribue à l’artificialisation des sols et leur fin de vie créée une pollution additionnelle.
Des entreprises peu mobilisées sur les impacts climatiques
Malgré ces impacts, l’usage de l’IA est parfois promu comme un moyen de contribuer à la transition écologique. Dejan Glavas cite l’exemple d’une IA prévoyant de manière « plus précise » la production d’électricité d’un parc éolien, ce qui permet « d’utiliser davantage les énergies renouvelables ». Pour autant, l’effet des solutions numériques « bénéfiques à la transition écologique sont, pour beaucoup, peu ou moyennement significatifs en comparaison avec d’autres moyens de décarbonation », peut-on lire dans un avis de l’Ademe publié en janvier. Et les IA utiles pour la transition sont généralement « de petits modèles spécialisés, qui ne sont pas des solutions en soi mais doivent être pensées selon le cadre social dans lequel elles s'inscrivent », explique Lou Welgryn, la secrétaire générale de Data for good, une ONG engagée pour un « numérique d’intérêt général ». Il ne s’agit donc pas d’IA génératives utilisées par le grand public comme ChatGPT.
Pour que l’IA puisse avoir plus de bénéfices que d’effets délétères sur le climat, il faudrait encore que les modèles soient utilisés à cette fin par les entreprises. « Ce n’est pas la tendance qu’on observe. Leur priorité numéro un, ce sont les gains de productivité, ce qui veut dire produire plus sur la même durée, et donc plus de consommation d’énergie et de matière », détaille Dejan Glavas, en s’appuyant sur le baromètre IA Entreprise et durabilité, publié par l’école Essca avec le cabinet Forvis Mazars en juin 2024. La moitié des entreprises répondantes sont « d’ores et déjà convaincues que l’IA a été bénéfique sur [leur] performance ». Seuls 12 % des répondants indique que leur entreprise prend en compte l’impact climatique lors de la mise en œuvre de l’IA.
La priorité numéro un des entreprises , ce sont les gains de productivité, ce qui veut dire produire plus sur la même durée, et donc plus de consommation d’énergie et de matière »
Dejan Glevas, professeur associé à l'Essca
L’IA peut améliorer l’exploitation de ressources fossiles
« On nous explique que l’IA va résoudre le problème climatique, mais jamais comment », dénonce Lou Welgryn de Data for good. En revanche, l’IA sert à des projets contribuant directement au changement climatique. Par exemple, elle « facilite l’extraction et la recherche de ressources fossiles, ainsi que la gestion des puits », illustre la spécialiste.
« L’IA, et plus largement le numérique, est un catalyseur du système dans lequel on l’intègre », peut-on lire dans le rapport du Shift project. Déployer l’IA sans « une stratégie globale de décarbonation (...), c’est construire une IA qui restera tout autant fossile que l’économie dans laquelle on la place », notent les auteurs.
Une dérégulation en cours ?
Dans cette situation, pour choisir les usages qui méritent de persister ou d’apparaître et ceux qui doivent être abandonnés, le Shift project suggère entre autres d’organiser un débat public impliquant la société civile ainsi que les acteurs publics et privés concernés. Lou Welgryn considère aussi nécessaire de faire appel aux citoyens. « Il faut apporter des réponses politiques à ce sujet, sortir d’un débat strictement économique et technique », avance-t-elle.
Elle recommande par ailleurs de mettre en place des règles pour encadrer l’usage de l’IA, en s’appuyant par exemple sur les propositions de la Green screen coalition - qui préconise entre autres d’imposer des limites à la consommation énergétique des centres de données ou d’encadrer l’extraction minière. Elle appelle aussi à ne « pas seulement déréguler » et dénonce le projet de loi de simplification de la vie économique, actuellement en discussion au Parlement. S’il était adopté en l’état, un centre de données « [revêtant] une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale » pourrait « être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur ». Cette reconnaissance permet d’accélérer sa construction. Elle facilite l’obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées.
Il faut apporter des réponses politiques à ce sujet, sortir d’un débat strictement économique et technique »
Lou Welgryn, secrétaire générale de Data for good
Mais que répondre à l’argument selon lequel la France doit investir dans l’IA, pour sa souveraineté, et pour rester dans la course économique ? « Il faut inverser la réflexion : se demander quels sont nos besoins, la société dans laquelle on a envie de vivre et les valeurs qu’on veut défendre, et ensuite, réfléchir à la manière dont on atteint ces objectifs, et avec quelles technologies. L'IA ce n'est pas quelque chose de magique ! Il faut arrêter de vouloir mettre de la technologie partout et de foncer sans se poser la question des énormes impacts environnementaux et sur les droits humains », répond Lou Welgryn.
Célia Szymczak 
(*) Pour l’Insee « l’intelligence artificielle rassemble et utilise des données pour prédire, recommander ou décider, avec des niveaux d’autonomie variés, la meilleure action pour aboutir à des résultats spécifiques. » Les technologies relevant de l’IA peuvent par exemple être l’apprentissage automatique ou la génération automatique de texte.
(**) Pour le Shift project, en France, « l’intelligence artificielle désigne les applications d’automatisation les plus avancées, à un moment donné, en matière de traitement de l’information, de complexité des tâches, de précision et de fiabilité. » La spécificité de l’’intelligence artificielle générative réside « dans sa capacité à produire de l'information avec des propriétés inédites », comme sa rapidité, sa polyvalence et son réalisme.