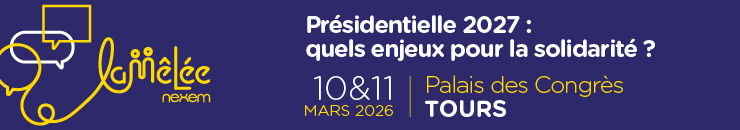L’ANTISÈCHE – Au fait, c’est quoi la désobéissance civile ?
Longtemps associée à des figures historiques comme Gandhi ou Martin Luther King, la désobéissance civile est aujourd’hui portée sur le devant de la scène par les mouvements écologistes. Comment se définit ce moyen d'action militant ?

« Dura lex sed lex », affirme une célèbre locution latine, prônant le respect et l’attachement à la loi, quelles qu’en soient les circonstances. Pas de quoi convaincre les partisans de la désobéissance civile, qui, s’ils acceptent les conséquences légales de leurs actions, rejettent l’application stricte d’une norme qu’ils estiment illégitime.
« La désobéissance civile est une action illégale ou transgressive d’une loi ou d’une norme, en vue d’interpeller les politiques publiques ou l’état de droit sur des questions de justice ou d’iniquité », définit Sylvie Ollitrault, politiste, directrice de recherche au CNRS, directrice de la recherche de la Haute de l'École des hautes études en santé publique et coautrice de l’ouvrage La désobéissance civile.
Des droits civiques aux mouvements écologistes
Ce mode d’action militant a été utilisé à plusieurs reprises dans des épisodes emblématiques de l’histoire du XXe siècle. Ce fut le cas des militants pour les droits civiques aux États-Unis, des suffragettes réclamant le droit de vote des femmes au Royaume-Uni, des contestataires de l’Allemagne de l’Est ou encore de la Marche du sel, initiée par Gandhi pour réclamer l’indépendance de l’Inde.
Par leur non-violence, ils montraient la violence de l’État. " Sylvie Ollitrault, politiste.
« Les partisans de la désobéissance civile insistaient à l’origine beaucoup sur le caractère citoyen et non-violent de leurs actions. Par leur non-violence, ils montraient la violence de l’État », explique Sylvie Ollitrault. Chez Gandhi, la désobéissance civile était même revendiquée comme une démarche spirituelle, reposant sur le fait que tout être humain est capable de bonté et peut-être converti à la vérité.
Ces dernières années, la désobéissance civile, est reprise sous de nouvelles formes par différents mouvements écologistes. Dans les nombreux exemples médiatisés, se retrouvent par exemple l’organisation Just Stop Oil et ses actions chocs dans les musées pour alerter sur l’urgence climatique ou encore les manifestations d’opposition à de grands aménagements menées malgré les interdictions, comme celles à l’encontre des mégabassines à Sainte-Soline.
À lire également : Actes militants contre les œuvres d’art : « Ces jeunes sont des lanceurs d’alerte » , Alice Audouin d’Art of Change 21 
Un concept ancien, théorisé au XIXème siècle
Cette méthode d’engagement, qui suscite parfois la controverse, se fonde sur des racines philosophiques plus anciennes. Elle a notamment été théorisée au XIXe siècle par le philosophe et naturaliste américain Henry David Thoreau dans son essai au titre fondateur La Désobéissance civile.
L’auteur y raconte un épisode de 1846 où, retiré dans une cabane dans les bois, il refuse de payer un impôt en signe de protestation contre le gouvernement esclavagiste des États-Unis, avant d’être arrêté et de passer une journée en prison. Pour Thoreau, la désobéissance civile se fonde sur la conscience morale de l’individu qui la pratique. Elle peut être considérée comme telle dans la mesure où l’individu agit pour la société tout entière, et non seulement dans son intérêt personnel.
« Thoreau a théorisé le concept et a bien expliqué sa dimension transgressive, mais des formes de désobéissance civile existaient auparavant », souligne Sylvie Ollitrault. La notion se retrouve par exemple dans la tragédie antique Antigone, dans l’histoire des objecteurs de conscience ou encore dans le mouvement religieux du quakerisme, fondé en Angleterre au milieu du XVIIe siècle. « Les Quakers étaient capables d’obéir aux normes, sauf quand ils les considéraient injustes », relate la chercheuse.
Il y a un retour de bâton avec des États qui criminalisent les actions de désobéissance civile". Sylvie Ollitrault, politiste.
Une pratique qui évolue et dérange
Aujourd’hui, le procédé militant connaît des évolutions dans ses pratiques. Par exemple, « le sabotage comme action de désobéissance civile est plus contemporain », relève Sylvie Ollitrault.
Pour ses partisans, ce mode d’action est justifié par l’urgence, en particulier l’urgence climatique, et par l’absence d’écoute de la parole des citoyens. « Il y a une dimension d’alerte qui est de plus en plus présente », pointe Sylvie Ollitrault, qui estime qu’il y a « une transformation de la désobéissance civile en elle-même et une transformation de sa réception par la société ».
« La désobéissance civile est justifiée par ceux qui la pratiquent de manière contemporaine comme un moyen de derniers recours », analyse-t-elle. Défendue par ses partisans comme un canal d’expression citoyen, elle fait néanmoins face à de la répression. « Les écologistes se sont emparés de cette manière de faire. Mais actuellement, il y a un retour de bâton avec des États qui criminalisent les actions de désobéissance civile », remarque la politiste.
Une méthode démocratique ?
D’une manière générale, la désobéissance civile renvoie à des tensions entre des individus ou des groupes d’individus, et l’État. Elle est considérée comme un mode d’action démocratique par ses partisans, qui, en théorie, acceptent les conséquences juridiques de leurs actions, notamment en se présentant devant le juge en cas de procès et en purgeant les peines appliquées.
Mais cette méthode d’action, non reconnue par la majorité des systèmes juridiques, n’est pas exempte de critiques. La définition de la violence et de la non-violence, quant aux actions des militants, fait ainsi souvent l’objet de débats. La légitimité des opposants, face à un pouvoir élu selon des règles démocratiques, peut également être remise en question. « La désobéissance civile se situe un peu sur un fil, avec le risque de tomber d’un côté ou de l’autre », résume Sylvie Ollitrault.
Élisabeth Crépin-Leblond