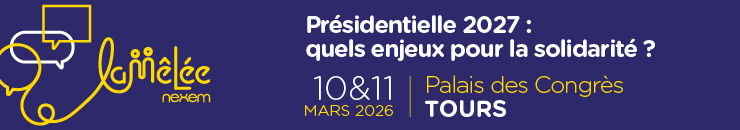IA : un baromètre montre comment les directions RSE s'en saisissent dans les entreprises
Wavestone a publié avec l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) le Baromètre RSE 2025. Cette édition porte notamment sur l’utilisation de l’IA à des fins sociales et environnementales, ainsi que sur la prise en compte des impacts de ces technologies dans les entreprises.

L’intelligence artificielle « ouvre des perspectives inédites » pour les actions de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), c’est-à-dire pour leurs engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). C’est ce qu’estime Cédric Baecher, associé chez Wavestone, en introduction du Baromètre RSE 2025 réalisé par le cabinet de conseil avec l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) et publié le 23 octobre. Cette année, il porte en particulier sur le potentiel et les impacts de l’IA pour la RSE.
En effet, les technologies d’intelligence artificielle peuvent être utiles, mais ont aussi des conséquences environnementales et sociales. Leur intégration « appelle un cadrage rigoureux et une vigilance éthique renforcée », souligne Cédric Baecher. « Le champ des possibles est immense. Encore faut-il maîtriser les risques », confirme Hélène Valade, la présidente de l’Orse. En France, seuls 37 % des répondants considèrent que plus de la moitié des collaborateurs de leur entreprise disposent d’une connaissance des enjeux de l’IA générative et l’utilisent avec discernement. C’est le cas dans 83 % des entreprises sondées au Royaume-Uni et 65 % des entreprises sondées en Allemagne.
À lire aussi : Des dynamiques « insoutenables » : quel est l’impact environnemental réel de l’IA ? 
Des technologies ciblées pour réduire les impacts
Les 359 répondants, remplissant des fonctions RSE dans des entreprises françaises, allemandes et britanniques, ont aussi été interrogés sur leurs usages de l’IA. Aucune utilisation particulière « ne semble actuellement prédominer, reflétant une phase d’exploration et d’expérimentation », peut-on lire dans le baromètre.
Des exemples sont toutefois cités : pour 59 % des répondants, l’IA contribue à la « mesure » et à la « communication » de la « performance ESG », notamment en automatisant la rédaction de synthèses et de rapports (38 %), en contribuant à la collecte des données (34 %) et à leur analyse, modélisation et visualisation (33 %) ou à la sensibilisation et la formation des salariés (33 %), par la création de contenu par exemple.
Les technologies d’IA peuvent aussi avoir des fonctions « plus ciblées » comme « des systèmes de scan des plateaux-repas pour quantifier le gaspillage alimentaire ou encore l’optimisation énergétique des bâtiments », notent les auteurs du baromètre. Muriel Signouret, directrice RSE du groupe SNCF et présente au webinaire de restitution du baromètre, donne l’exemple d’un logiciel permettant aux conducteurs de trains « d’optimiser leurs pratiques de conduite et de stationnement ». Des outils peuvent également être utilisés pour vérifier la conformité des rapports demandés aux entreprises sur leurs impacts sociaux et environnementaux, ou encore pour prédire les risques climatiques.
L’implication de la RSE, garante de la prise en compte de l’empreinte écologique ?
Au-delà de leur usage de l’IA, les directions RSE contribuent aux réflexions sur les manières d’utiliser l’IA générative de façon « éthique » et « durable » en Allemagne dans 89 % des cas et au Royaume-Uni dans 91 % des cas, mais de façon plus limitée en France (dans 47 % des cas). Or, cette implication des directions RSE « les positionnent comme garantes de son usage responsable et de son potentiel au service de la durabilité », insistent les auteurs.
En effet, lorsque les directions RSE sont impliquées, les trois quarts des arbitrages de projets en lien avec l’IA intègrent un critère environnemental. Ce critère n’est pris en compte que dans un quart des cas lorsqu’elles ne sont pas impliquées.
Des risques psychosociaux identifiés par les directions RSE
La prise en compte des risques psychosociaux – c'est-à-dire les facteurs susceptibles de porter atteinte à la santé mentale ou physique des travailleurs en suscitant du stress ou de la souffrance psychique – liés à l’intelligence artificielle constituent « une dimension essentielle » de la RSE, ajoutent les auteurs. 75 % des entreprises dans lesquelles les directions RSE contribuent à la réflexion sur l’usage de l’IA générative ont mené un travail d’identification de ces risques, contre 22 % des entreprises dans lesquelles les directions RSE ne sont pas associées aux réflexions.
45 % des répondants ayant effectué ce travail considèrent que les craintes ou l’anticipation du « remplacement du travail humain par l’IA » constituent un risque psychosocial. 38 % estiment que l’affaiblissement de la reconnaissance professionnelle du travail accompli et des compétences en est un, en lien avec la « déstabilisation des modes de reconnaisssance et/ou à un sentiment de perte d’autonomie ». « L’anxiété liée au manque d’éthique ou de transparence des décisions prises avec l’IA notamment en raison des risques de contrôle et de surveillance de la productivité et du travail » et l’accroissement de la charge de travail pour apprendre à maîtriser l’IA sont aussi identifiés comme des risques par 37 % et 36 % des répondants.
À lire aussi : Burn-out : comment la dégradation des conditions de travail dans les entreprises menace la santé des salariés 
Outre la question de l’intelligence artificielle, le baromètre donne des éléments sur l’intégration de la RSE dans les stratégies d’entreprise. Elle en fait « de plus en plus partie », a déclaré Cédric Baecher lors du webinaire de restitution du baromètre. Malgré un contexte de backlash avec des retours en arrière sur le sujet au niveau politique, « les entreprises gardent le cap », a assuré Hélène Valade, la présidente de l’Orse.
Elle observe la croissance de la prise en compte de la RSE à l’échelle de la gouvernance et des équipes opérationnelles. Pour quasiment huit répondants sur dix (77 %), la RSE est davantage prise en compte par la gouvernance de l’entreprise que les années précédentes. Moins de 2 % constatent une régression. 86 % des personnes sondées assurent que la RSE « est portée par des leaders identifiés et est valorisée dans les échelons de gouvernance ». Huit sur dix (82 %) affirment que la RSE influence les choix d’investissements, les produits et les modèles économiques - même s’ils ne sont que sept sur dix à l'affirmer parmi les répondants français.
Toutefois, une partie des conseils d’administration et de direction ne se « saisissent » pas encore de la RSE, tempère Hélène Valade. En France, « l’appropriation des enjeux RSE demeure hétérogène selon les métiers », peut-on également lire dans le baromètre. Près d’un quart des répondants (24 %) déclarent aussi que les moyens mis en œuvre restent insuffisants pour atteindre les objectifs fixés. Le premier frein identifié dans le déploiement de la stratégie RSE est d'ailleurs le manque de ressources humaines et de temps (à 42 %) ; le deuxième est le manque de directives et la dépriorisation par les équipes des sujets en raison d’autres objectifs (41 % des sondés) ; le troisième est le manque d’expertise et la complexité des sujets (à 37 %).
À lire aussi : RSE : les professionnels veulent relativiser les reculs sociaux et environnementaux dans les entreprises 
Célia Szymczak