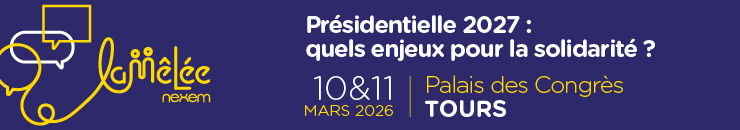Territoires zéro chômeur, une expérimentation qui pourrait être pérennisée : « le vrai sujet, c’est le droit à l’emploi »
Dans les Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD), des personnes durablement éloignées de l’emploi sont embauchées en CDI, pour réaliser des activités répondant à des besoins non satisfaits. Actuellement en phase d’expérimentation, elle pourrait être pérennisée par une loi. Le chercheur Timothée Duverger présente l’initiative et revient sur les enjeux liés à sa poursuite.

En France, plus de 2,4 millions de personnes sont durablement éloignées de l’emploi. Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD), une initiative portée par des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), a permis d’embaucher plus de 5 600 d’entre elles depuis 2017. À ce jour, elle est mise en œuvre par 83 territoires comptant 5 000 à 10 000 habitants.
TZCLD est pour le moment une démarche dite expérimentale, encadrée par une loi votée en 2020. L’expérimentation doit s’achever en juin 2026. Une proposition de loi visant à sa pérennisation, portée par le député Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) Stéphane Viry, est en cours de discussion.
Timothée Duverger est chercheur, responsable du master Économie sociale et solidaire et innovation sociale de Sciences po Bordeaux et président de l’Observatoire des Territoires zéro chômeur de longue durée. Il a co-dirigé un ouvrage publié fin août intitulé Territoires zéro chômeur de longue durée : de l’expérimentation à l’institutionnalisation (Le bord de l'eau). Il répond aux questions de Carenews pour présenter l’initiative et les enjeux liés à sa pérennisation.
- Pouvez-vous nous présenter Territoires zéro chômeur de longue durée ?
Cette expérimentation s’appuie sur trois convictions – personne n’est inemployable, ce n’est pas le travail qui manque, ni l’argent –, pour mettre en œuvre concrètement le droit à l’emploi, inscrit dans la Constitution de 1946 avec le devoir de travailler.
Cela se décline dans un projet, porté au niveau territorial. Il part de l’envie et des savoir-faire des personnes privées durablement d’emploi, c’est-à-dire de la demande d’emploi, pas de l’offre. On confronte cette demande aux besoins non satisfaits du territoire. Pour y répondre, on crée des emplois de qualité, en CDI, payés à minima au Smic et à temps choisi, dans des entreprises à but d’emploi (EBE), qui doivent être des associations ou des coopératives.
Le comité local pour l’emploi (CLE) est l’instance de gouvernance du projet. Présidé par un élu local, il réunit des acteurs locaux, comme des associations ou des acteurs économiques, et des personnes privées d’emploi. Celles-ci doivent coconstruire le projet.
- Quels types d’activités les personnes réalisent-elles ?
C’est extrêmement diversifié. Si je prends le cas du projet de Bordeaux par exemple, il y a une EBE qui porte des activités de conciergerie de quartier, d’économie circulaire et numérique et de ferme urbaine et pédagogique. Pour synthétiser, ils mettent en œuvre le plus souvent deux grandes catégories d’activités : celles qui concourent au lien social et celles qui participent de la transition écologique.
- Quels ont été les effets des expérimentations déjà menées ?
Il y a des effets positifs du point de vue de l’insertion des personnes par l’emploi, y compris pour les personnes porteuses de handicap qui représentent près d’un quart des effectifs. Cela se traduit par une amélioration du bien-être à travers l’estime de soi, le lien social ou la santé. On a aussi des gains sur le plan monétaire : elles gagnent un peu plus d’argent. Comme ce sont des emplois en CDI, il y a une sécurité vis-à-vis de l’avenir, qui leur permet de se projeter.
Les effets territoriaux sont un peu moins analysés par les évaluations, mais on peut les percevoir. L’expérimentation réunit beaucoup d’acteurs autour d’un projet d’insertion, génère des dynamiques collectives. Elle contribue au développement du territoire, crée de nouveaux services, qui répondent à des besoins non satisfaits.
Mais nous sommes en attente du rapport final du comité scientifique chargé d’évaluer l’expérimentation.
- Est-ce qu’on peut parler d’une politique innovante, différente des politiques de l’emploi traditionnelles, et si oui, pourquoi ?
Pour moi, il y a deux innovations principales. D’abord, le fait de partir des personnes elles-mêmes pour créer des emplois autour de leurs demandes, autant que possible. Évidemment, il y a différentes contraintes : il faut que ce soit une activité suffisamment solvable, non concurrentielle avec ce qui existe sur le territoire.
Le deuxième aspect, c’est que l’action publique est coconstruite au niveau territorial par une diversité d’acteurs.
Ces innovations encouragent un changement de paradigme dans les politiques de l’emploi : l’emploi est une responsabilité collective plutôt qu’individuelle.
Ces innovations encouragent un changement de paradigme dans les politiques de l’emploi : l’emploi est une responsabilité collective plutôt qu’individuelle.
- Une aide publique est versée pour le financement de chaque poste en EBE. Tout en soulignant « l’efficience des actions mises en place », la Cour des comptes parle dans un rapport publié en juin dernier de « déséquilibre financier », appelant à une « rationalisation ». Est-ce que cette politique est coûteuse, par rapport aux autres politiques de l’emploi et par rapport à ses effets ?
Oui et non. C’est plus élevé que les aides aux postes classiques [versées aux structures de l'insertion par l'activité économique (IAE), qui proposent des emplois temporaires], mais c’est un dispositif de création d’emplois pérennes. La Cour des comptes a établi ce chiffre à 28 000 euros par emploi, mais cela ne prend pas en compte l’inflation et la revalorisation des minimas sociaux, ni surtout les coûts évités (indemnités de chômage, aides sociales) et les manques à gagner (cotisations, impôts, taxes).
Ce qu’on peut dire, c’est que le modèle économique reste à consolider, mais comme le souligne la Cour des comptes elle-même « cette expérimentation fait localement la preuve de son utilité, en particulier pour répondre à des publics pour lesquels aucune solution n’était proposée. (…) La normalisation de cet accompagnement au sein des politiques publiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle est souhaitable à l’issue de dix années d’expérimentation ».
- Les activités mises en place dans les EBE peuvent-elles être rentables ?
Certaines peuvent potentiellement l’être. Mais les personnes au chômage de longue durée ont une productivité beaucoup plus faible que la moyenne. Et les activités de l’EBE ne doivent pas être concurrentielles. Cela signifie qu’aucun acteur du territoire ne doit les avoir déjà mises en œuvre, et donc que ce sont en général des activités faiblement rentables.
Il y a de plus en plus d’exigences en matière de rentabilité portées par les pouvoirs publics, à la fois en raison de contraintes budgétaires et de normes sociales (la glorification du travail et de la performance) mais il faut trouver un équilibre. Il s’agit de créer des emplois porteurs d’utilité sociale. L’exigence de rentabilité peut avoir des effets pervers, par exemple conduire à sélectionner les personnes les plus performantes et exclure celles qui sont les plus éloignées de l’emploi.
- Le fait que le coût de l’emploi des personnes en EBE est compensé par des coûts évités liés au chômage est débattu.
C’était l’hypothèse de départ de TZCLD. Il y a des controverses, différents chiffrages. On attend une étude de France Stratégie sur le sujet : on manque de données. C’est un grand débat avec des problèmes méthodologiques : quels coûts on prend en compte pour en établir le coût net, c’est-à-dire les dépenses moins les coûts évités et les recettes ? Les coûts indirects liés à la santé ou l’échec scolaire peuvent-ils être qualifiés, par exemple ?
Il y a également des effets de relance. C’est l’hypothèse que défend l’économiste postkeynésienne Pavlina R. Tcherneva dans son ouvrage sur La garantie d’emploi (La découverte, 2020). On donne du pouvoir d’achat, ce qui a des effets sur la consommation et la croissance. On ne peut pas réellement les mesurer sur des expérimentations locales.
Le vrai sujet, c’est le droit à l’emploi. Est-ce qu’on considère aujourd’hui qu’il est important que la société mette ces moyens sur la table pour permettre à chacun de retrouver un emploi et de se sentir utile à la société ? Le débat de fond est d’abord politique.
Est-ce qu’on considère aujourd’hui qu’il est important que la société mette ces moyens sur la table pour permettre à chacun de retrouver un emploi et de se sentir utile à la société ? Le débat de fond est d’abord politique.
- Les deux lois créant et prolongeant l’expérimentation, votées en 2016 et en 2020, ont bénéficié d’un soutien transpartisan. En même temps, la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet a parlé en juin dernier des « réelles interrogations que soulève ce dispositif », mentionnant notamment un risque de « gâchis d’argent public ». Quel soutien politique peut-il obtenir ?
La première loi, portée par un député socialiste, a été voté sous François Hollande ; la deuxième par une députée En marche sous Emmanuel Macron. Stéphane Viry porte la proposition de loi discutée actuellement, c’est un homme de droite. Ce qu’il faut observer, c’est qu’un relatif consensus demeure dans les débats à l’Assemblée nationale, malgré les positionnements incertains du ministère. Le projet est soutenu par toute la gauche. Les centristes soutiennent assez mollement, mais ils soutiennent. La droite est divisée : cela dépend des individus. Le Rassemblement national ne s’y oppose pas, il s’est même déclaré plutôt favorable.
Selon la manière dont on regarde le projet, on peut s’y retrouver à gauche et à droite, c'est ce qui fait sa force. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut promouvoir l’emploi et que les territoires ont un rôle à jouer. Les gens de gauche sont sensibles à la participation des personnes, les gens de droite sont sensibles au retour à l’emploi.
La notion de consensus est au cœur du projet, du niveau microlocal jusqu’à l’Assemblée nationale. L’une des premières missions du comité local pour l’emploi, c’est de créer un consensus territorial.
Selon la manière dont on regarde le projet, on peut s’y retrouver à gauche et à droite, c'est ce qui fait sa force. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut promouvoir l’emploi et que les territoires ont un rôle à jouer.
- La proposition de loi actuellement discutée au Parlement vise à pérenniser l’expérimentation et « à ouvrir la possibilité à de nouveaux territoires volontaires de candidater », selon les mots de Stéphane Viry. Est-il souhaitable de généraliser cette politique publique plus largement ?
Le débat budgétaire tourne autour du déficit public, de la dette et de l’austérité. On ne va pas mettre beaucoup d’argent sur la table. Pérenniser ce qui existe, voire le déployer un peu, c’est déjà très positif.
Il serait souhaitable d’en faire une politique ambitieuse, qu’il faudrait porter au niveau national comme européen, à l’instar des premières initiatives prises par Nicolas Schmitt dans la précédente Commission ou de sa diffusion dans plusieurs pays comme la Belgique. Bravo aux acteurs d’avoir réussi à convaincre de l’intérêt de la pérennisation malgré le contexte politique et financier du pays. Mais ce n’est sans doute qu’une étape sur le chemin du droit à l’emploi, qui doit mener à une garantie d’emploi territoriale avec les moyens associés.
À lire aussi : « Territoires zéro chômeur a tout changé pour moi ! » 
Propos recueillis par Célia Szymczak