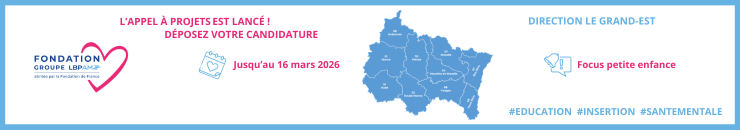Aide internationale : « un plan social majeur » est en cours dans le secteur (Kevin Goldberg, Solidarités International)
La baisse généralisée des financements étatiques en 2025 a plongé le secteur humanitaire dans une période de crise, entre arrêts de certains programmes et plans de licenciement. Plus d’un an après la suspension de l’USaid, Kevin Goldberg, directeur général de l’ONG Solidarités International revient pour Carenews sur les conséquences ressenties par son organisation et les perspectives d’adaptation pour le futur.

- Carenews : Le 24 janvier 2025, Donald Trump fraîchement élu, a annoncé la suspension des programmes de l’agence des États-Unis pour le développement international (USaid). Un an plus tard, comment cette décision vous-a-t-elle affecté ?
Kevin Goldberg : Ça a été un choc. Nous nous attendions à ce qu’il y ait un changement dans la politique américaine mais nous ne pensions pas qu’ils appuieraient sur un bouton rouge appelé « suspension complète de l’aide ».
De plus, ça a été extrêmement mal géré. Nous recevions des injonctions contradictoires, nous disant d’arrêter un programme puis trois jours plus tard de le redémarrer. Nous avons terminé cette séquence assez horrible avec beaucoup d’incertitudes et de stress pour les équipes, par un arrêt définitif de cinq programmes déployés en Mozambique, en Afghanistan et au Yémen.
Pour certaines zones, nous avons bénéficié d’un soutien d’autres bailleurs de fonds qui ont pris la suite. Par exemple en Mozambique, l’Union européenne a permis la continuité de certaines de nos opérations. Mais ce n’est pas vrai partout. Nous avons essayé de compter au niveau mondial le nombre de personnes affectées par ces coupes et nous sommes arrivés à un chiffre de 200 000 personnes. En parallèle, des projets qui ont pu reprendre vont arriver à terme bientôt. Nous avons une incertitude très forte sur la poursuite d’un soutien américain au-delà de fin mars 2026.
- Avez-vous dû licencier des salariés ?
Oui, nous avons dû mettre en place un plan de licenciement. Au siège, nous avons dû nous séparer de plus de 35 % de notre masse salariale. Au niveau mondial, nous prévoyons une baisse progressive de près de 20 % de nos équipes.
À l’heure actuelle, Solidarités International compte 2 600 salariés au niveau international, contre 3 000 salariés auparavant.
C’est une façon assez terrible de gérer l’argent public, parce que nous sommes incapables de mettre en place des logiques de résilience pour les populations »
- Votre budget était déjà passé de 190 millions d’euros en 2023 à 167 millions en 2024. À combien s’est élevé votre budget en 2025 ? Quelles prévisions pour 2026 ?
En 2025 notre budget prévisionnel s’est élevé à 152 millions d’euros d’opérations humanitaires et 158 millions d’euros au global. En 2026, nous avons un budget prévisionnel de 132 millions. Entre 2023 et 2026, nous avons donc perdu 30 % de notre budget.
- Les pays européens ont aussi procédé à des réductions budgétaires. La France a notamment réduit l’enveloppe allouée à l’aide publique au développement de 2,1 milliards en 2025. Cela vous a -t-il affecté ?
Oui, nous avons des programmes qui sont non-renouvelés, notamment ceux portés avec l’Agence française de développement (AFD). Nous signons des projets pour une durée d’un an et demi en moyenne. Donc, ce que nous n’avons pas signé en fin d’année dernière et cette année aura un impact l’an prochain.
Le niveau de baisse de l’aide publique au développement n’est pas très éloigné ce qu’ont fait les États-Unis. En 2025, la France a essayé de maintenir une partie de son aide humanitaire mais toute son aide de résilience et d’accompagnement des pays en sortie de crise ou en fragilité chronique s’est effondrée. La partie « soutien aux ONG » de l’AFD a vu ses budgets fondre de façon catastrophique.
Nous avons donc encore un peu de capacité sur l’urgence mais rien pour prendre la suite. C’est une façon assez terrible de gérer l’argent public, parce que nous sommes incapables de mettre en place des logiques de résilience pour les populations. De son côté, l’AFD va être aujourd’hui obligée de se recentrer sur les logiques de prêts, c’est-à-dire aller sur des programmes avec des États qui sont capables de rembourser. Cela laisse de côté les pays les plus fragiles, les plus endettés et ceux sur lesquels les besoins d’assistance humanitaire sont les plus forts.
- Avez-vous conclu de nouveaux contrats avec les États-Unis cette année ?
Non, nous n’avons pas encore conclu de nouveaux contrats depuis 2024. Nous avons simplement des prolongations de contrats existants.
Nous sommes toutefois en discussion à propos de nouveaux contrats, notamment ceux qui vont transiter par les Nations unies. Avant la suspension de l’aide, les États-Unis dépensaient entre 15 et 17 milliards de dollars par an pour l’aide humanitaire. Fin décembre 2025, ils ont annoncé faire un don de 2 milliards d’euros aux Nations unies pour l’aide humanitaire en 2026. C’est une goutte d’eau par rapport à avant, mais qui est la bienvenue.
Il y a néanmoins des contraintes très fortes. Les États-Unis demandent notamment que tout soit dépensé en six mois. C’est une assez mauvaise gestion de l’aide, notamment s’il y a besoin de faire du sur-mesure et d’aller chercher ceux qui n’ont aucun accès à l’aide.
Nous aimerons pouvoir avoir des logiques de transition dans lesquelles nous remettrions les clés de notre aide, soit aux autorités locales, soit à des ONG nationales, si elles en sont capables. Mais très souvent, nous ne sommes pas dans cette situation »
- Après les suspensions brutales de l’année dernière, êtes-vous plus réticents à travailler avec eux ?
Nous sommes surtout très prudents. Nous regardons très en détail les conditions attachées à la mise en œuvre de projets par les États-Unis pour qu’elles respectent les principes humanitaires : pouvoir choisir qui sont les personnes qui vont bénéficier de l’aide sur la base uniquement des besoins et non sur des considérations ethniques, religieuses ou autres ; pouvoir travailler en ciblant les personnes les plus vulnérables, souvent les filles ou les femmes ; agir sur des questions liées à l’impact du changement climatique dans les pays les plus vulnérables.
Si ces conditions-là sont validées, alors nous continuerons à faire appel à ces financements. Nous considérons que notre action première, qui est de sauver des vies et de venir en aide aux populations, prime sur le risque que l'on prend.
Lire également : Les 5 grands enjeux de l’aide humanitaire internationale 
- En parallèle de la baisse des financements, les besoins humanitaires, eux, n’ont pas diminué. Concrètement, comment priorisez-vous vos actions ?
Cela nous demande de faire des arbitrages un peu durs : s’il n’y a pas un très haut niveau de sévérité, nous arrêtons. Et, malheureusement, nous sommes amenés à abandonner des zones entières.
Souvent, les choix sont contraints. Si un financement pour un zone est interrompu, alors nous arrêtons nos actions dans cette zone. Par exemple, nous avions de grosses opérations à l’est du Liban, en soutien aux populations syriennes qui vivent dans des camps de déplacés. Ces opérations-là font les frais de la baisse de financement et nous avons été obligés d’arrêter des projets, notamment de distribution d’eau. C’est un choix difficile pour les équipes et surtout décorrélé du niveau de demande : nous savons que ces populations ont encore besoin d’eau.
Par ailleurs, nous aimerons pouvoir avoir des logiques de transition dans lesquelles nous remettrions les clés de notre aide, soit aux autorités locales, soit à des ONG nationales, si elles en sont capables. Mais très souvent, nous ne sommes pas dans cette situation. Dans cet exemple du Liban, quelques familles auront les capacités financières de se procurer de l’eau mais beaucoup d’autres seront privées de service. Elles vont donc se redéplacer, refaire face à des risques importants et trouver des mesures alternatives, comme faire travailler les enfants : toute la logique qui se met en place quand l’assistance est défaillante.
Aux États-Unis, des collectifs se sont montés pour aider les organisations à faire face à la fermeture de l’USaid. Ils ont réussi à réunir plusieurs centaines de millions de dollars »
- Depuis un an, avez-vous développé des pistes pour répondre à ces baisses de financement ?
Nous avons beaucoup travaillé sur le fait d’aller chercher des bailleurs de fonds que nous n’avions pas jusqu’à présent. Je pense par exemple aux Suédois avec qui nous discutons aujourd’hui. Les pays du Golfe sont également des acteurs en train de monter en puissance en termes de volumes de financement et avec lesquels nous avons une discussion assez approfondie pour, je l’espère, avoir un jour des soutiens.
Nous redoublons aussi d’ardeur sur les collectes de dons. Nous sommes encore convaincus qu’il y a un soutien qui ne se dément pas auprès de la population française et européenne.
Lire également : Crise dans la solidarité internationale : comment les ONG peuvent-elles s’adapter ?
- Essayez-vous aussi de mobiliser le mécénat ?
Nous le faisions déjà avant. Mais les fondations croulent sous les demandes. Il y a peu d’acteurs privés français qui sont spécialisés sur l’international, beaucoup qui ne font que du national, et quelques-uns qui font les deux.
Malheureusement, le secteur est assailli de demandes, à la fois d’associations françaises, également impactées lourdement par une baisse de financements publics, et par des acteurs internationaux comme nous.
Aux États-Unis, des collectifs se sont montés pour aider les organisations à faire face à la fermeture de l’USaid. Ils ont réussi à réunir plusieurs centaines de millions de dollars. Nous sommes en discussion avec l’un de ces collectifs pour le financement d’une opération. Nous serions très heureux que les mêmes dynamiques se jouent en France. Mais aujourd’hui, la prise de conscience de l’impact à long terme de la baisse des financements publics français est plus faible.
- Dans son discours de janvier devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a appelé à « faire davantage avec le secteur privé » pour « réinvestir l’aide publique au développement ». Qu’en pensez-vous ?
Nous avons besoin du secteur privé pour faire de l’investissement dans les pays en développement parce que la puissance publique ne peut pas porter à elle seule la transition écologique et énergétique d’un certain nombre de pays qui ont besoin d’investissements directs.
Mais les zones où nous intervenons sont des zones très fragiles. Une entreprise ne peut pas espérer un retour sur investissement fort. Nous sommes plutôt dans une logique de long terme : le fait d’investir aujourd’hui participe de la stabilité et de la santé des populations qui, in fine, aura un impact économique.
Malgré tout, il y a un vrai enjeu économique. Le fait d’investir autant sur la défense et la sécurité militaire et de désinvestir autant sur les questions de stabilité et d’aide humanitaire est, pour moi, une forme d’incohérence. Les conflits coûtent extrêmement cher à l’économie mondiale.
Les gens que l’on prive d’eau et d’alimentation au Yémen ou en Afghanistan ne vont pas manifester dans les rues de Paris »
- L’année dernière, vous évoquiez le risque « d’un mouvement de déresponsabilisation des pays riches à l’égard des populations faisant face aux crises ». Sentez-vous ce mouvement s’opérer ?
Nous continuons d’observer des discours qui soutiennent l’action humanitaire et ses principes chez un grand nombre d’acteurs européens. Mais dans les choix budgétaires, ce mouvement s’opère, oui, bien sûr.
C’est une déresponsabilisation vis-à-vis des personnes qui vivent des crises, mais aussi vis-à-vis des générations futures. L’instabilité de pays en guerre et en crise a un impact sur la santé mondiale, sur les déplacements forcés et sur l’adaptation au changement climatique. Ces défis-là ne connaissent pas de frontières. Se dire que l’on peut laisser tomber car nous n’avons plus les moyens est pour moi une vraie erreur stratégique.
Par ailleurs, l’aide publique au développement représente moins de 1 % du budget de l’État. C’est une mesure d’économie facile car elle se voit moins : les gens que l’on prive d’eau et d’alimentation au Yémen ou en Afghanistan ne vont pas manifester dans les rues de Paris. Mais c’est une économie minuscule par rapport à l’équilibre budgétaire de la France et qui a des impacts majeurs sur des millions de personnes.
- Vous évoquiez également un risque de perte d’expertise du secteur et de connaissance des besoins. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Certaines choses que l’on craignait ne se sont pas réalisées. Par exemple, un mécanisme d’analyse des famines, qui à un moment a été inopérant du fait des coupes américaines, a repris en capacité. C’est quand même une bonne nouvelle.
Toutefois, certains chiffres annoncés cette année par les Nations unies ne sont pas très cohérents. Les baisses de financement ont entraîné une réduction des pays dans lesquels le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire est évalué. Par exemple, le Nigeria ou le Cameroun, où il y a des zones de crise humanitaire, sont sortis du périmètre. La conséquence est que le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire est passé de plus de 300 millions en 2025 à environ 240 millions en 2026. Les 60 millions de personnes en question n’ont pas disparu, elles ont été laissées de côté.
Il y aussi des conséquences en termes d’expertises métiers, liés aux différents départs. Dans le cadre de notre plan de licenciement, nous avons dû nous séparer d’un certain nombre de spécialistes. Comme nous sommes moins nombreux, nous sommes obligés de rendre les postes plus généralistes. Et beaucoup de ceux qui partent, malheureusement, font le choix d’abandonner l’humanitaire pour se tourner vers autre chose.
- Dans une étude publiée à la fin de l’année 2025, Coordination Sud évoquait la nécessité de développer « des pratiques de coopération inter-associatives », par exemple en mutualisant les ressources. Est-ce un point que vous développez ?
Oui, nous sommes très mobilisés sur ce sujet. Nous sommes dans les membres fondateurs d’une coopérative qui s’appelle Hulo pour « humanitarian logistics » et qui rassemble une quinzaine d’ONG afin de mettre en commun nos achats et certaines de nos ressources humaines. Nous arrivons ainsi à négocier des prix d’achat un peu plus faibles pour le matériel humanitaire et à ne pas démultiplier un exercice assez coûteux en temps et en capacité humaine.
Au-delà de la logistique, nous allons être exposés de plus en plus à des questions de rapprochement entre acteurs, de mutualisation, fusion etc. Ce qui est en train de se passer, c’est quand même un plan social majeur sur le secteur : certaines ONG vont malheureusement fermer. Ce sera donc essentiel d’essayer de sauvegarder l’expertise via des logiques de rapprochement, sans mettre en danger la santé économique des ONG qui restent debout.
Lire également : 1 300 projets arrêtés et 10 000 emplois supprimés dans la solidarité internationale, calcule Coordination Sud 
- Comment vous projetez-vous pour 2026 ?
Nous avons connu une année 2025 difficile. Après un déficit de plus d’un million d’euros, nous serons à l’équilibre en 2026. Aujourd’hui, nous essayons de stabiliser, de nous redonner une capacité de nous projeter vers l’avant et de garder notre capacité de réactivité en cas de nouvelles urgences.
Cela va prendre du temps à se matérialiser en termes d’impact sur le terrain mais nous voulons retrouver un peu de force et de capacité à effectuer notre travail, sans être uniquement dans la gestion quotidienne de tel et tel projet qui s’interrompt. Nous voulons retrouver un peu de combativité.
Propos recueillis par Élisabeth Crépin-Leblond