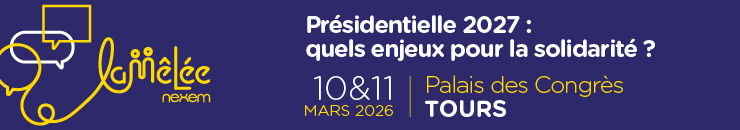Insertion, lutte contre la pauvreté, sport... Les acteurs de l’ESS dénoncent la « surdité » du gouvernement face à leurs problématiques
Plusieurs réseaux représentants les associations et autres structures de l’économie sociale et solidaire, réunis à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 22 octobre, protestent contre le projet de budget pour 2026 présenté par le gouvernement.

« Nous comprenons parfaitement (...) que les acteurs économiques et la nation doivent faire des efforts » face au déficit public et à la dette, assure Benoît Hamon, le président d’ESS France, l’organisation représentative des acteurs de l’économie sociale et solidaire, lors d’une conférence de presse organisée le 22 octobre. Mais « il y a quelque chose de profondément injuste et déséquilibré » dans le projet de loi de finances pour 2026 présenté le 14 octobre, soutient-il. D’après lui, les économies envisagées seraient réalisées « sur le dos des personnes les plus vulnérables dans notre pays » et des organisations de l’ESS, qui représentent « 7 % des aides publiques aux entreprises pour 14 % de l’emploi privé », « quand les autres seraient mis à contribution marginalement », avance-t-il.
Pas de mesure de lutte contre la pauvreté
Dans le viseur des acteurs de l’économie sociale et solidaire, il y a d’abord la proposition du gouvernement de ne pas revaloriser à hauteur de l’inflation les prestations sociales, comme les allocations familiales ou les aides au logement « Il y a une immoralité absolue au fait de geler les pensions et les minima sociaux, et dans le même temps de refuser une taxe de 2 % sur les 1 500 fortunes les plus importantes du pays », pense Benoît Hamon, faisant référence au refus par le gouvernement de la proposition de taxe dite Zucman, du nom de l’économiste qui la défend.
« Ce gel des prestations va conduire à renvoyer des centaines de milliers de personnes de plus sous le seuil de pauvreté », prévient Delphine Rouilleault, la présidente du Collectif Alerte, qui réunit 37 organisations de lutte contre la précarité. Dans un contexte « d’augmentation très forte de la pauvreté » — elle n’a jamais été aussi élevée depuis que l’Insee la mesure de cette manière, en 1996 —, la proposition aurait pour conséquence de « réduire les moyens de subsistance des dix millions de Français les plus pauvres de notre pays ». Elle déplore une « déconnexion » du gouvernement, inconscient selon elle des conséquences concrètes de cette mesure. « 15, 20 ou 30 euros » par mois, c’est, pour les plus précaires d’entre nous, « la capacité à pouvoir boucler le budget, à faire un plein de courses », détaille-t-elle.
« Beaucoup d’autres mesures, par ailleurs, vont contribuer à aggraver les difficultés dans la vie quotidienne des Français », ajoute-t-elle, mentionnant par exemple la proposition de doublement des franchises médicales, une somme que les assurés doivent régler sur les boîtes de médicament, les transports sanitaires et les actes paramédicaux. Elle dénonce aussi « l’absence » de mesures de lutte contre la pauvreté dans le projet de budget du gouvernement.
À lire aussi : Budget 2026 : 60 ONG appellent à « inverser la logique » du projet du gouvernement sur les questions sociales et environnementales 
Des financements pour le retour à l’emploi
Le projet de budget cible aussi les organisations qui contribuent à l’accès des personnes précaires à leurs droits fondamentaux, fustige Benoît Hamon. ESS France lance notamment l’alerte sur la situation des structures d’insertion par l’activité économique (IAE), qui permettent à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver du travail. Les 200 millions d’euros de coupes annoncées conduiront à accompagner 60 000 personnes de moins, avance David Horiot, qui représente le Collectif IAE, constitué de dix réseaux d’insertion.
« Ce qui est proposé est une démarche perdante pour tout le monde : les territoires, les entreprises et surtout les personnes en situation de précarité », déplore-t-il. Les structures d’insertion emploient souvent des personnes « dans des territoires délaissés », comme les territoires ruraux ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville, note Tarek Daher, le délégué général d’Emmaüs France. « C’est ce tissu économique qu’on fragilise aussi en cassant les dynamiques d’emploi », fustige-t-il.
Les structures de l’IAE demandent donc 237 millions d’euros de financement supplémentaire par rapport au projet de budget, pour atteindre le niveau du PLF 2024. Aux yeux du collectif, il faut aussi abonder le fonds de développement de l’inclusion, qui finance le développement de l’IAE, à hauteur de 40 millions d’euros. Enfin, ils appellent à augmenter le budget dédié à la formation des salariés en insertion.
Ce qui est proposé est une démarche perdante pour tout le monde : les territoires, les entreprises et surtout les personnes en situation de précarité »
David Horiot, collectif IAE
Des liquidations d’associations se multiplient
Au-delà de l’IAE, le secteur associatif dans son ensemble – qui emploie 1,9 million de salariés – subirait de nombreuses coupes si le projet de budget du gouvernement était appliqué en l’état. Ces réductions budgétaires concernent par exemple l’aide publique au développement, l’économie circulaire, les radios associatives, le mentorat, le service civique ou encore le sport.
Le manque à gagner total est évalué par Claire Thoury, la présidente du Mouvement associatif, à un milliard d’euros, « sans compter ce que les collectivités territoriales vont devoir absorber », puisqu’elles devront, elles aussi, faire des efforts financiers qui risquent de se répercuter sur les financements versés aux associations.
Pourtant, depuis des mois, les associations lancent l’alerte au sujet de leurs difficultés économiques et se sont mobilisées le 11 octobre sur ce sujet. « J’ai l’impression qu’on passe notre temps à répéter la même chose et que c’est de pire en pire », déplore Claire Thoury. Environ 500 liquidations d’associations ont été comptabilisées par le Mouvement associatif depuis le 1ᵉʳ janvier, soit un doublement par rapport à la même période en 2023. 30 % des associations employeuses disposent actuellement de moins de trois mois de trésorerie et 90 000 emplois associatifs sont menacés, dans « tous les secteurs », indique la présidente du Mouvement associatif. Le Secours catholique et l’association Aides ont annoncé récemment des plans sociaux.
En règle générale dans l’ESS, au deuxième trimestre 2025, 1 800 emplois ont été supprimés dans les champs de l’éducation, 1 200 dans les sports et les loisirs, 550 dans le secteur mutualiste, 530 dans l’aide à domicile. Benoît Hamon observe « une multitude de suppressions de postes, ici dans une crèche, là dans un Ehpad, là dans une association de sport, partout sur le territoire ». Avec pour conséquence, des besoins qui « restent sans réponse » et « des besoins qui étaient satisfaits et qui ne le sont plus ».
À lire aussi : Associations : face aux difficultés, des risques de liquidation ? 
Un « mauvais pari économique »
« Nous ne sommes pas en train de demander un service à nos interlocuteurs publics », appuie Claire Thoury. « Nous sommes en train de [leur] rappeler et de [leur] redire que notre modèle social tient grâce à l’action associative, déplore-t-elle. La question, c’est dans quelle société nous voulons vivre, quels sont les arbitrages que nous sommes prêts à faire pour bien vivre ensemble. Faire le choix de l’anti-associatif, c’est faire le choix d’une société hyper marchandisée. »
Des associations agissent dans les secteurs de la petite enfance, du périscolaire ou des services aux personnes âgées, « de manière morale, pas chère, plutôt que les grands groupes financiers qui se dressent sur la fragilité de nos concitoyens » avance David Cluzeau, président de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes). « Si demain l’économie sociale et solidaire n’est plus là pour rendre les services qu’elle rend aujourd’hui, l’économie va s’effriter », alerte-t-il, qualifiant le projet de budget de « mauvais pari économique ».
L’Udes alerte spécifiquement sur la proposition de suppression de l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficient les associations et acteurs non lucratifs, qui « [mettrait] en péril la continuité de l’offre de soin, d’accueil et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire national », selon l’organisation. À cela s’ajoute « l’augmentation de plusieurs contributions », comme une « nouvelle taxe sur les avantages salariés ». Cette hausse des charges conduirait les entreprises de l’ESS à faire face à un « effet ciseaux » estime David Cluzeau : moins de soutien public, et en parallèle, une hausse des coûts.
Notre modèle social tient grâce à l'action associative.»
Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif
Une « surdité » du gouvernement
« Nous avons l’impression que la société civile ne pèse pas dans le débat public depuis quelque temps », observe Tarek Daher, d’Emmaüs France. Il parle d’une forme de « surdité du gouvernement » : les associations n’ont pas été reçues par un ministre après leur mobilisation du 11 octobre ; les acteurs de l’insertion n’ont pas été convoqués par le ministère du Travail après avoir alerté sur leurs besoins ; le Collectif Alerte a été entendu par François Bayrou seulement sept mois après sa nomination, illustre le responsable associatif.
« Il y a quelque chose d’offensant » dans l’attitude du gouvernement, abonde Benoît Hamon. Le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (GSEF) se tiendra à Bordeaux la semaine prochaine, du 29 au 31 octobre, et aucun ministre n’a selon lui annoncé sa venue.
Célia Szymczak