L’ANTISÈCHE - Au fait, c’est quoi la responsabilité élargie des producteurs (REP) ?
Les structures mettant des produits sur le marché sont en partie contraintes par la loi de gérer et de prévenir la création de déchets issus de leur fin de vie. Ce principe s’appelle la responsabilité élargie des producteurs, organisée par filières.
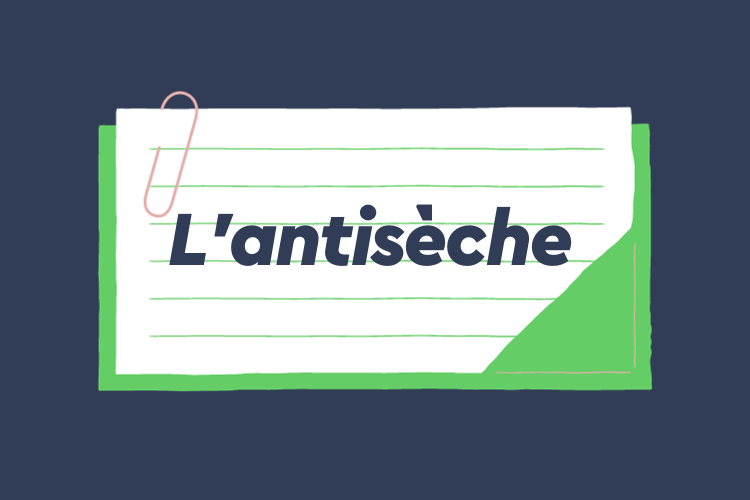
La responsabilité élargie des producteurs (REP) désigne le principe selon lequel les structures qui mettent des produits sur le marché sont responsables de la fin de vie de ces produits, donc de la prévention et de la gestion des déchets. Il existe dans la loi française depuis 1975, a été mis en place en 1992 avec la première filière REP déchets ménagers.
En effet, la responsabilité élargie des producteurs est organisée par filière, c’est-à-dire par type de produits. Elles sont prévues par la loi. Il en existe par exemple une pour les articles de sport et de loisir, une pour le bâtiment, les équipements électriques et électroniques… 18 filières REP étaient actives en juin 2024, 25 devraient l’être d’ici à 2025. Plusieurs d’entre elles sont prévues dans le droit européen.
Adoptée en 2020, la loi Agec a imposé la création de neuf filières sur les 25. Elle a aussi créé l’obligation de prévenir la création de déchets (par le réemploi des objets, par exemple, qui a un impact environnemental bien moins élevé que le recyclage ou l’incinération), en plus de les gérer. Elle a par ailleurs modifié le système d’organisation des filières.
À lire aussi : Les acteurs du réemploi solidaire s’unissent face au privé lucratif 
Gestion par des éco-organismes
La REP est une application du principe de pollueur-payeur, selon lequel le responsable d’une pollution est aussi chargé de sa gestion ou de son évitement. En intégrant les coûts de gestion des déchets, le producteur est censé être incité à les réduire en développant des produits éco-conçus.
Soit les producteurs gèrent individuellement leurs produits en fin de vie, soit ils mettent en place des structures collectives appelées éco-organismes pour le faire. Ce sont des structures privées à but non lucratif agréées par l'État. Les producteurs leur versent alors une cotisation financière appelée éco-contribution. Son montant peut être modulé avec des primes ou des pénalités selon l’impact environnemental du produit. Plus celui-ci est vertueux, plus la cotisation peut être réduite. En retour, une pénalité peut être imposée pour la production d’un produit non vertueux.
Des marges de progrès dans la mise en œuvre du système ?
Ce système « a permis de réaliser des progrès en matière de collecte et de recyclage des déchets » mais il existe « d’importantes marges de progrès », estime une mission d’inspection dans un rapport rendu le 18 juillet intitulé « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur ». « 40 % du gisement de déchets soumis à une REP échappe encore à la collecte et 50 % n’est pas recyclé », peut-on lire dans le document. Dans deux tiers des filières, les objectifs de collecte ne sont pas atteints. Les auteurs du rapport effectuent des recommandations pour améliorer l’efficacité des filières.
De même, un rapport publié en avril par l’association Zero Waste France conclut à « un impact limité des filières REP » et propose aussi des pistes d’amélioration. Le rapport fait le constat d’une tendance à la hausse des mises en marché de déchets, du développement faible du réemploi et d’une diminution limitée des déchets incinérés ou mis en décharge.
À lire aussi : Loi Agec : des propositions pour aller plus loin 
Célia Szymczak 

