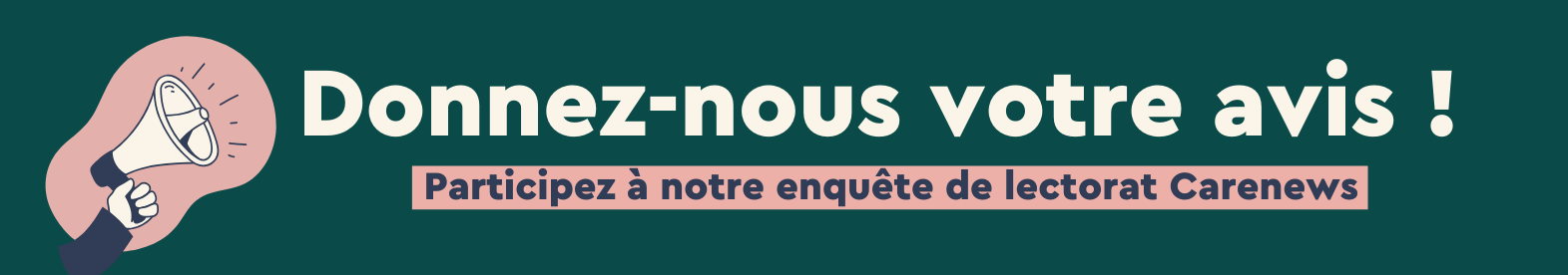La loi Duplomb adoptée en dernière lecture
Le texte de la loi Duplomb, défendu par les syndicats agricoles majoritaires et décrié par de nombreuses associations, a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale mardi 8 juillet. Si certaines mesures ont été effacées en commission mixte paritaire, il prévoit notamment la réintroduction sous dérogation de l’acétamipride, un pesticide interdit en France depuis 2020.

Les mobilisations des associations n’ont pas abouti. La proposition de loi du sénateur Laurent Duplomb (Les Républicains) « visant à lever les contraintes du métier d’agriculteur » a définitivement été adoptée à l’Assemblée nationale mardi 8 juillet, à 316 voix contre 223. Élaboré en réponse aux manifestations des agriculteurs de janvier 2024, le texte revient sur un certain nombre d’obligations environnementales, dont l’interdiction en France depuis 2020 de l’acétamipride, un pesticide néonicotinoïde critiqué entre autres pour son impact sur les insectes pollinisateurs.
« Le texte a été voté, affaiblissant les normes sanitaires et environnementales et avec elles la biodiversité », dénonce Henri Godron, président de la coopérative Biocoop. « Un choix dramatique pour la santé de la population et la préservation des écosystèmes », considère de son côté Gabriel Malek, président d’Alter Kapitae. « L’Assemblée nationale vient d'adopter un texte destructeur pour l’agriculture en toute impunité », accuse encore l’association Terre de Liens.
L’acétamipride réintroduit au nom de la « souveraineté alimentaire »
Passée par un parcours législatif houleux, ayant fait l’objet d’une motion de rejet de la part de ses partisans, la proposition de loi Duplomb remaniée en commission paritaire maintient finalement l’indépendance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Les articles permettant le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures ont également été réécrits pour davantage d’encadrement, mais introduisent toujours une présomption d'« intérêt général majeur » pour les projets d'ouvrages de stockage dans les zones dans lesquelles le manque d'eau est « pérenne » et compromet « le potentiel de production agricole ». Ceux, prévoyant de créer une nouvelle catégorie de « zones humides fortement dégradées » et moins protégées, ont été supprimés.
En revanche, l’utilisation de l’acétamipride, par dérogation, est de nouveau autorisée, suscitant l’indignation des associations environnementales et de certains collectifs de lutte contre le cancer, qui ont organisé de nombreuses manifestations ces dernières semaines. « C’est un recul majeur lorsqu’on connaît les effets néfastes des pesticides sur la santé des agriculteurs », dénonçait par exemple avant le vote, Yann Arthus-Bertrand, président de la fondation GoodPlanet. « La loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, qui a fixé un cap d’interdiction de l’usage des pesticides de type néonicotinoïdes [est] purement jetée aux oubliettes, au mépris des effets avérés de cette famille de pesticides sur la santé humaine et sur les insectes pollinisateurs », alertait également 26 associations dans une lettre ouverte initiée par UFC-Que Choisir. « Cette décision confond sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire, au détriment de la santé publique. Pourtant les chercheurs sont unanimes : l’exposition chronique aux néonicotinoïdes, ces « tueurs d’abeilles » contaminant tous les milieux, soulève de vives inquiétudes pour la santé humaine », ajoute mercredi 9 juillet la Fondation pour recherche médicale.
À lire également : Des associations chiffrent « l’injuste prix de notre alimentation » 
L'article 3 de la loi prévoit également des mesures facilitant l'agrandissement ou la création de bâtiments d'élevage intensif. Les députés de droite ont voté en grande partie en faveur du texte, à l’inverse de la gauche qui s’y opposée, tandis que le centre macroniste s’est montré plus divisé. Surnommé « loi poison » par ses détracteurs, le texte a été salué par la ministre de l’agriculture Annie Genevard qui la considère comme « le chemin de la reconquête de notre souveraineté alimentaire ». Cet argument rejoint celui des syndicats agricoles majoritaires qui ont convaincu l’hémicycle et qui dénonçaient une distorsion de concurrence face à des produits européens et internationaux soumis à des normes environnementales moins strictes. Les députés socialistes ont, eux, annoncé mardi soir saisir le Conseil constitutionnel pour demander la censure du texte.
Une loi-cadre comme réponse ?
Au lendemain de l’adoption, le cabinet de conseil en affaires publiques Greenlobby, accompagnant les entrepreneurs à impact, a de son côté annoncé se mobiliser pour l’adoption d’une loi-cadre sur l’agriculture et l’alimentation.
« Face aux reculs imposés par la loi Duplomb, il est vital de proposer un autre cadre : celui d’une agriculture juste, durable, résiliente. C’est qui le patron?, Max Havelaar France, La fourche, Léa Nature, Biocoop et le Collectif En Vérité ont déjà démontré leur intérêt », partage-t-il dans un communiqué.
À lire également : Amendements « prêts à l’emploi », pantouflage… Un rapport de Greenlobby dénonce l’influence des grandes entreprises industrielles dans la fabrique de la loi 
Élisabeth Crépin-Leblond