Entreprises « à mission » : vrai levier d’engagement ou outil de greenwashing ?
Toutes les entreprises peuvent devenir « société à mission » si elles inscrivent dans leurs statuts une « raison d’être » ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux, dont l’atteinte est ensuite vérifiée. Cela permet-il de véritables changements ? Vivien Pertusot, spécialiste et auteur d’un ouvrage sur le sujet, répond aux questions de la rédaction.
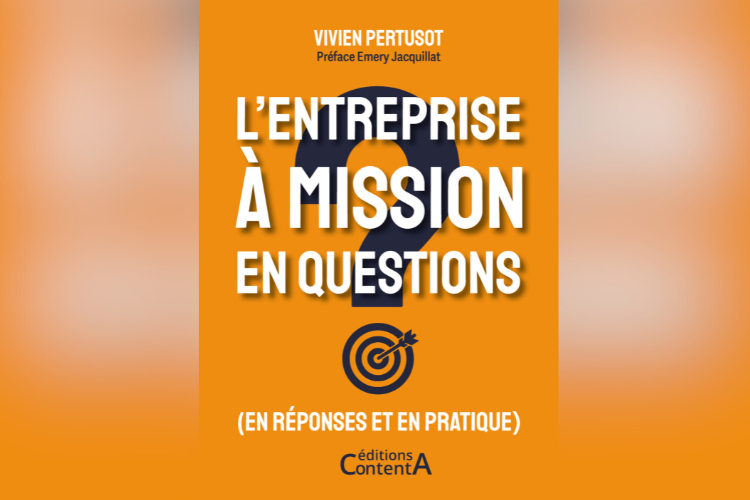
Quel est le point commun du groupe Danone, de la marque de vêtements Sézane, de la Banque Postale ou de Doctolib ? Ces quatre entreprises font partie des 2 295 sociétés à mission de France, qui inscrivent dans leurs statuts leur volonté de contribuer à des objectifs sociaux ou environnementaux. Le fait d’être une société à mission est une « qualité juridique », prévue par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, adoptée en 2019.
Vivien Pertusot, auteur de la newsletter La Machine à sens consacrée à cette question, conseille des sociétés à mission ou des entreprises souhaitant le devenir. À partir des informations accumulées au fil des newsletters et dans son expérience de consultant, il publie L’entreprise à mission en questions (ContentA, 2025) à destination de celles ayant déjà adopté cette qualité ou en réflexion sur le sujet. Il répond aux questions de Carenews sur la portée transformatrice du modèle.
-
Carenews : Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est une société à mission ?
Vivien Pertusot : Le cadre de la société à mission est juridique et volontaire, ouvert à toutes les sociétés commerciales.
Elles inscrivent dans leur statut une raison d’être, c’est-à-dire un engagement en quelques mots ou quelques phrases affirmant le fil conducteur de leur activité, et des objectifs sociaux et/ou environnementaux associés.
Cela leur permet de montrer comment leur activité peut avoir un impact positif sur leurs parties prenantes – leurs collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs –, la société et l’environnement, mais aussi d’utiliser ce cadre pour consolider, structurer, parfois accélérer leurs engagements.
À lire également : Les entreprises à mission ont-elles du mal à transformer l’économie ? 
-
La raison d’être ne comprend pas forcément d’aspects sociaux ou environnementaux ?
VP : Globalement, il y a très peu d’articles de loi sur la société à mission. Juridiquement, la raison d’être n’a pas forcément d’objet social ou environnemental.
La plupart du temps, dans la pratique, des enjeux sociaux ou environnementaux y sont toutefois intégrés.
-
L’atteinte des objectifs par l’entreprise est-elle vérifiée ?
VP : Un organisme tiers indépendant (OTI) accrédité vérifie les engagements pris par l’entreprise au bout de 18 ou 24 mois puis tous les deux ou trois ans en fonction de la taille de la société. Le premier audit est fait la plupart du temps avec une certaine souplesse, c’est plutôt un audit de « mise aux normes ». Mais en revanche, lors des audits suivants, s'il n’y a pas eu de progression dans les moyens mis en œuvre, les efforts ou si l’objectif est trop peu ambitieux, les auditeurs sont en droit de conclure au non-respect d’un objectif.
Il y a aussi un organe de contrôle interne, un comité de mission pour la plupart des entreprises [il peut être remplacé par un référent pour celles de moins de 50 salariés]. Il réunit des personnes de l’entreprise, et souvent des personnes extérieures, qui apportent un regard un peu distancié par rapport aux engagements, testent et développent de nouvelles idées en lien avec la mission. Le comité de mission ne doit pas se satisfaire d’une entreprise qui ne cherche pas à progresser. Il a un rôle consultatif, mais peut avoir un impact assez important.
Les collaborateurs qui travaillent dans une société à mission se posent aussi des questions sur la réalité des engagements. Cela peut se traduire par des critiques, des désengagements ou des démissions, ce que j’ai observé dans quelques témoignages.
Les collaborateurs qui travaillent dans une société à mission se posent aussi des questions sur la réalité des engagements. Cela peut se traduire par des critiques, des désengagements ou des démissions, ce que j’ai observé dans quelques témoignages.
-
Est-ce qu’il y a une obligation d’affecter des moyens à l’atteinte de la mission et des objectifs ?
VP : Il n’y a pas d’obligation légale, mais les entreprises à mission doivent rédiger un rapport annuel, le comité de mission ou le référent doit suivre son déploiement, il y a une vérification extérieure, ce qui suppose des moyens.
-
Vous indiquez dans votre ouvrage que « trop d’entreprises passent à côté du sujet » dans la formulation de la raison d’être. Les auditeurs ont-ils un regard sur le sujet ?
VP : Ils n’analysent pas la nature de la raison d’être ou des objectifs. Mais le comité de mission peut jouer ce rôle-là.
Il y a souvent un écart entre la manière dont la mission est formulée et la réalité du terrain. Souvent, les entreprises en font plus, mais elles n’ont pas forcément compris comment traduire toutes les actions déjà mises en œuvre et les projets futurs dans la raison d’être et les objectifs. Certaines entreprises n’accordent pas assez de temps à la formulation de la mission ou ne veulent pas afficher une ambition trop forte de peur de ne pas l’atteindre.
Par ailleurs, beaucoup d’entreprises passent à côté du sujet parce que les missions qu’elles se fixent reflètent leur activité aujourd’hui et pas leur avenir. Dans ce cas, la mission n’aide pas à se poser des questions sur ce qui pourrait être modifié ou abandonné. C’est ma principale crainte aujourd’hui : que les entreprises n’utilisent pas suffisamment leur mission pour se poser des questions stratégiques parce que la formulation est trop peu tournée vers l’avenir, trop périphérique ou trop large.
-
Les audits sont-ils réalisés ?
VP : J’ai fait une petite étude sur 500 entreprises il y a deux ans. Théoriquement, elles sont obligées de publier l’avis de l’organisme tiers indépendant sur leur site internet. C’est une preuve publique que l’entreprise a bien réalisé son audit.
En 2023, 76 % des entreprises ne l’avaient pas publié. Cela ne veut pas dire que l’audit n’a pas été fait. D’après mes échanges avec des auditeurs, on était probablement à une entreprise sur deux.
Je pense que la situation s’est améliorée aujourd’hui.
À lire également : Rapport exclusif : seules 24 % des sociétés à mission devant publier l’avis d’audit l’ont fait 
-
Toute entreprise peut-elle devenir société à mission, peu importe la nature de son activité et même si celle-ci a un impact très négatif sur l’environnement ou la société ?
VP : Théoriquement, oui. C’est l’avantage de la souplesse du modèle : la société à mission n’impose pas aux entreprises qui se lancent dans cette démarche d’avoir un niveau de maturité sur des enjeux sociaux ou environnementaux. Mais elle exige qu’elles se placent une démarche d’amélioration continue de leur impact positif ou de diminution de leur impact négatif, contrôlée à travers les audits de l’OTI et la surveillance du comité de mission.
Des entreprises dont le modèle d’affaires paraît problématique sur les enjeux sociaux ou environnementaux peuvent très bien utiliser le cadre de société à mission pour se transformer. Cela peut paraître étonnant, mais la société à mission n’est pas un label de vertu. Le point essentiel, c’est la volonté de progresser et d’opérer des changements qui peuvent parfois être très profonds.
Des entreprises dont le modèle d’affaires paraît problématique sur les enjeux sociaux ou environnementaux peuvent très bien utiliser le cadre de société à mission pour se transformer. La société à mission n’est pas un label de vertu.
-
Dans le livre, vous mentionnez le cas d'Emeis, le nouveau nom d'Orpea, dont les pratiques ont été dénoncées par l’enquête Les Fossoyeurs, de Victor Castanet (Fayard, 2022), et qui a adopté la qualité de société à mission. Vous estimez que cela n’est pas contradictoire.
VP : Il y a eu un certain nombre de critiques quand cela a été annoncé. Mais la qualité de société à mission permet à ces entreprises de dire qu’elles vont l’utiliser pour résorber des dysfonctionnements internes et améliorer leurs pratiques.
-
Est-ce qu’on peut déjà observer les effets concrets des missions sur l’action sociale et environnementale des entreprises qui en ont adopté ?
VP : Ce n'est pas parce qu'on devient société à mission que des effets apparaissent immédiatement. Ils sont le fruit d’efforts continu, d’un réel investissement humain et financier.
Le pilier environnemental revient très fréquemment dans les missions. La majorité des entreprises à mission ne sont pas soumises aux réglementations environnementales en raison de leur petite taille : elles se lancent souvent dans la réalisation d’un bilan carbone alors qu’il n’y a pas d’obligation pour elles de le faire, par exemple. D’autres utilisent la mission pour accélérer leurs efforts environnementaux.
La société à mission peut guider l’innovation dans l'entreprise en mettant les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de la réflexion. Elles réfléchissent sur leur activité, sur leur modèle d’affaires, leur organisation par exemple, ce qu’elles pourraient faire de plus, différemment, ou de moins.
J’ai une meilleure connaissance des entreprises qui ne sont pas des grands groupes. Dans ce cas, je ne sais pas si ça a un impact sur la totalité de l’activité, même s’il y en a forcément sur certains métiers, activités ou directions.
Ce n'est pas parce qu'on devient société à mission que des effets apparaissent immédiatement. Ils sont le fruit d’efforts continu, d’un réel investissement humain et financier.
-
Toute personne intéressée peut saisir le tribunal de commerce dans le cas où les conditions pour être une société à mission ou les objectifs ne seraient pas respectés. Ce mécanisme n’a, d’après vous, jamais été activé. La mission peut-elle vraiment être transformatrice dans ces conditions ?
VP : Je pense que le fait qu’on puisse contester la qualité de société à mission est très peu connu, mais j’espère que ça arrivera. Il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu, ce sont des brebis galeuses qui donnent une mauvaise image de la qualité de société à mission au global.
Est-ce que cela signifie que le cadre n’est pas transformatif ? A priori non. Aujourd’hui, il y a très peu d'intérêt à se lancer dans cette démarche pour de l’affichage, parce que la qualité n’est pas suffisamment connue. Les entreprises le font par conviction, ou en ayant conscience qu’il y aura des preuves à afficher ensuite.
Aujourd’hui, il y a très peu d'intérêt à se lancer dans cette démarche pour de l’affichage, parce que la qualité n’est pas suffisamment connue.
-
Vous soulignez que les efforts entrepris par les sociétés à mission ne sont pas récompensés. Faut-il créer des incitations, fiscales par exemple, à l’adoption de la qualité juridique ?
VP : Au départ, les concepteurs universitaires et les législateurs ont considéré que la société à mission devait être un choix volontaire et que mettre en place des incitations fiscales ou accorder des points dans les appels d’offres publics serait contre-productif, parce que cela pourrait amener des entreprises à se lancer dans la démarche par opportunisme.
Aujourd’hui, on constate que l’engagement a un coût : les entreprises investissent dans des actions qui ne sont pas forcément obligatoires. Cela peut jouer sur leur chiffre d’affaires et leur compétitivité. Il y a une discussion à avoir sur le fait qu’être société à mission apporte une forme d’avantage ou de reconnaissance par la puissance publique ou les financeurs publics.
Pour cela, il faudrait peut-être rendre la qualité de société à mission un peu plus contraignante, dans la manière dont les audits sont faits par exemple.
À lire également : « Nous souhaitons mieux faire connaître le cadre des sociétés à mission » (Hélène Bernicot, Communauté des Entreprises à Mission) 
Propos recueillis par Célia Szymczak 

