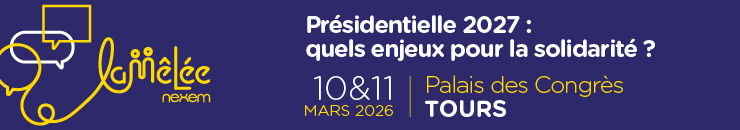Fatigue ou stress des salariés : et si la sieste au travail était une solution ?
Certaines entreprises installent dans leurs locaux des « salles de sieste ». Nommés parfois plus sobrement « salle de repos » ou « salle de détente », ces espaces offrent aux salariés la possibilité d’un moment de pause ou de sommeil, à l’abri des regards et de l’agitation. Socialwashing ou vraie mesure pour la qualité de vie au travail ?

N’avez-vous jamais eu envie de piquer du nez au travail, pris par une fatigue soudaine ? Ces baisses d’énergie, qui arrivent souvent en début d'après-midi, affectent directement nos capacités physiques et cognitives, ainsi que nos aptitudes à nouer des relations sociales. Bien que rarement prises en compte par les entreprises, elles s’inscrivent pourtant dans notre cycle physiologique. Et puisque tout problème nécessite une solution, une pratique séculaire réapparait doucement pour y répondre : la sieste.
« Un sas de décompression »
Pierre*, salarié dans le secteur des médias, dit avoir besoin « de beaucoup dormir ». Il a eu l’occasion de tester les salles de sieste de deux entreprises dans lesquelles il a travaillé. Pour lui une courte sieste de 20 à 30 minutes sur sa pause déjeuner, produit des effets bénéfiques immédiats. « Cela permet d’éponger la fatigue. Je suis plus concentré ensuite », met-il en avant. « J’aime bien faire une coupure pour reprendre un bon rythme et couper les écrans. Cela rend mon cerveau plus créatif et m’enlève un peu de stress », partage également Emma*, chargée de projet dans une association à Paris.
« Je commence mon après-midi dans de meilleures conditions. Je suis moins stressée », abonde Mathilde, salariée dans une agence de relations presse, dont les activités se situent entre Paris et Bordeaux. Dans les locaux de Nouvelle-Aquitaine, elle bénéficie d’une véritable « salle de repos », aménagée à la demande de sa directrice. Celle-ci est installée dans une pièce dédiée avec plaids, plantes, canapé, « fauteuils cosy » et même télévision. « C’est comme un sas de décompression, décrit la salariée. Avoir la possibilité de me requinquer joue sur ma concentration et ma motivation. Je me sens aussi plus disponible et apte à accompagner les stagiaires et les alternants qui me sont confiés. »
À lire également : Burn-out : comment la dégradation des conditions de travail dans les entreprises menace la santé des salariés 
Dans d’autres pays, dormir au milieu de sa journée de travail est une pratique largement répandue. En Chine, le « droit au repos » le midi est inscrit dans la constitution. En France, la pratique se développe peu à peu. En juillet dernier, Yannick Neuder, alors ministre de la Santé, s’est dit « très favorable à la sieste d’une façon générale, qu’elle soit dans le milieu professionnel ou à l’école », lors de la présentation d’une feuille de route interministérielle « en faveur d’un sommeil de qualité ».
La sieste, un « médicament » pour lutter contre les conséquences de la dette de sommeil
« Il y a clairement un regain d’intérêt pour le sujet », relève Brice Faraut, docteur en neurosciences et directeur de recherches sur les effets de la privation et de la récupération de sommeil dans l’unité de recherche Visafom (vigilance, fatigue, sommeil et santé publique), associée au centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu (université Paris Descartes-APHP).
« Selon les échantillons représentatifs de la population active française, 25 à 30 % des personnes sont en dette de sommeil », décrit l’auteur de l’ouvrage Sauvés par la sieste, petits sommes et grande victoire sur la dette de sommeil. Ces personnes dorment moins de 6 heures par 24 heures en semaine, ou il leur manque 60 à 90 minutes de sommeil de manière quotidienne, ce qui représente environ une nuit à la fin de la semaine.
Or, si les besoins varient en fonction des individus et de leur patrimoine génétique, « seulement 6,7 % de la population est constituée de "petits dormeurs" [ayant un besoin de sommeil inférieur à 6 heures par 24 heures] », insiste le neuroscientifique. À l’inverse, « les 10 % de la population qui ont besoin de dormir plus de 8 ou 9 heures par 24 heures sont souvent en manque de sommeil », relève-t-il.
Cette dette de sommeil provoque des conséquences très concrètes sur la santé des individus qui la subissent et sur leur capacité à mener à bien leurs tâches. Réduction de la concentration, moindre tolérance à la douleur, prise de poids, affaiblissement du système immunitaire et développement de maladies auto-immunes… Les impacts sont nombreux.
Face à ce constat, la pratique de la sieste peut agir « presque comme un médicament », démontre Brice Faraut dans son ouvrage. « De nombreuses publications scientifiques montrent que c’est un outil qui permet de récupérer un certain nombre de facultés du cerveau. En 10-15 minutes, la majorité des capacités cognitives sont déjà récupérées. La sieste permet aussi de réduire les marqueurs de stress dans le sang, ce qui contribue notamment à améliorer la santé cardiovasculaire et la tension artérielle », met-il en avant. Des siestes plus longues ou pratiquées régulièrement peuvent également jouer un rôle anti-inflammatoire, grâce à la libération d’hormones de croissance, ajoute le scientifique.
Quelque chose de complétement physiologique se produit. Environ sept heures après le réveil, la pression du sommeil commence à monter ».
Brice Faraut, neuroscientifique.
Une baisse naturelle de la vigilance en milieu de journée
Même sans dette de sommeil, la sieste en milieu de journée répond au cycle biologique humain : « le rythme circadien », explique Brice Faraut. Souvent associé dans les esprits à la digestion du déjeuner, le fameux « coup de barre » ressenti en début d’après-midi résulte en réalité de notre horloge interne, détaille-t-il.
« Quelque chose de complétement physiologique se produit. Environ sept heures après le réveil, la pression du sommeil commence à monter. Il y a un creux de vigilance, avec une très légère baisse de la température centrale et une diminution des hormones de stress », détaille-t-il. Des études ont ainsi montré que le début de l’après-midi est associé à une hausse des accidents de la route, comme vers 3 ou 4 heures du matin, ainsi qu’à une hausse des fautes de frappe sur les ordinateurs, signes parmi d’autres d’une baisse de la vigilance.
« Pour certains d’entre nous, la sieste est un indispensable si l’on souhaite avoir un après-midi et une soirée de qualité », souligne le neuroscientifique.
Un dispositif d’inclusion ?
« La salle de sieste est bénéfique pour une majorité de personnes, quels que soient leur état de santé et leur statut », considère de son côté Djamila Tedjani, directrice des ressources humaines (DRH) du groupe Oui Care. Au sein de son siège au Mans (Pays de la Loire), ce groupe spécialisé dans les services à la personne a aménagé une « salle de lecture et de sieste » ouverte à tous les collaborateurs.
Certains des 500 salariés du groupe qui travaillent au siège présentent néanmoins des besoins spécifiques. Par exemple, un grand nombre sont des femmes, mères d’enfants en bas âge. « Pour les parents, qui ont parfois des nuits très courtes, il y a un moment dans la journée où le peu d’heures de sommeil se fait sentir », détaille la DRH. La salle est également appréciée de collaboratrices du groupe confrontées à des douleurs menstruelles, constate-t-elle.
À lire également : Règles douloureuses, endométriose, ménopause en entreprise : le « congé menstruel, c’est une toute petite partie du sujet » 
Quand Anne-Laure Marin, fondatrice de l’agence dans laquelle travaille Mathilde, a acquis ses locaux l’année dernière, cette directrice a placé l’instauration d’une salle de repos « dans ses priorités ». « Je me sens responsable vis-à-vis de mes salariés. Notre travail est assez stressant et pouvoir se couper spatialement de la source continue d’informations fait du bien », analyse-t-elle.
L’importance de l’aménagement de la salle de sieste
Pour être bénéfique, encore faut-il que la sieste puisse être réalisée dans de bonnes conditions sur le lieu de travail. En France, un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives est prévu par le droit du travail dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives. Cette pause peut être accordée, soit immédiatement après cette durée de six heures, soit avant qu’elle ne soit écoulée. En pratique, une coupure plus longue est généralement actée, notamment par une convention collective ou un accord collectif d’entreprise.
« En théorie, les salariés sont libres de faire ce qu’ils veulent durant leur pause. Mais les lieux ne sont pas toujours adaptés de manière optimale à une sieste », relève Brice Faraut. Certains salariés se retirent par exemple dans leur voiture ou dans des salles de réunion vides pour se reposer, ce qui ne permet pas toujours une récupération idéale.
Au contraire, dans l’entreprise équipée d’une salle de sieste dans laquelle Pierre a travaillé « il y avait des canapés et des divans séparés par des paravents. La salle était plongée dans l’obscurité sans être dans le noir complet, et plutôt silencieuse ». Au sein du groupe Oui Care, la « salle de lecture et de sieste » est un espace clos et isolé qui peut accueillir jusqu’à six personnes. Plongé dans le noir complet et dans le silence, elle est équipée de six poufs géants, avec chacun une table de chevet et une veilleuse, pouvant prodiguer une lumière blanche de faible intensité. « À l’entrée, il y a un panneau avec six étiquettes pour que les salariés indiquent lorsqu’ils entrent dans la salle de sieste. L’idée est que chacun entre en silence pour gêner le moins possible les personnes qui s’y trouvent », explique Djamila Tedjani, directrice des ressources humaines du groupe.
Installer une salle de sieste lève un peu un tabou ».
Djamila Tedjani, DRH.
La sieste au travail : un tabou à lever ?
Malgré ces aménagements, la réticence des salariés demeure parfois, parce qu’ils sont peu habitués ou gênés. « J’encourage mes équipes à faire un break entre midi et 14 heures et un bout de sieste. Mais elles ne le font pas facilement car ce n’est pas bien vu dans la société française », partage ainsi Victor Cœur, cofondateur de Soqo. Dans les bureaux de son entreprise de 10 salariés à Paris, un canapé a été installé un peu à l’écart, derrière la bibliothèque de la salle commune. « J’ai grandi à Nîmes. Dans la culture méditerranéenne, faire une pause participe du bien-être mental. J’essaie de l’insuffler à mes équipes en faisant la sieste moi-même », explique-t-il.
« Dormir au travail, c’est a priori antinomique. Installer une salle de sieste lève un peu un tabou », reconnaît quant à elle Djamila Tedjani.
Pour que tous les salariés osent faire la sieste selon leurs besoins, les entreprises interrogées misent sur une mise en place la plus libre possible. « Il n’y a pas de badge ou de contrôle, chacun peut venir en fonction de son emploi du temps », présente Djamila Tedjani. « Aujourd’hui tout le monde y va ou presque », affirme-t-elle.
« Il faut que la direction ait conscience de l’horloge biologique humaine. Si l’instauration de la sieste est faite "en mode pansement", avec des horaires inadaptés, cela ne changera pas grand-chose », appuie également Brice Faraut. « Je ne pense pas que le simple fait d’avoir une salle de sieste suffise, mais cela participe à un ensemble global », témoigne quant à elle Anne-Laure Marin, de l’agence de presse. « Cela fait partie de la culture de l’entreprise. Les salariés restent parce que l’on prend soin d’eux », considère-t-elle.
À lire également : La semaine de 4 jours : révolution RH ou fausse bonne idée ? 
Au sein de son agence, l’accès à la salle de sieste est également libre. « D’une manière générale, les salariés n’y vont pas sur leurs horaires de travail, à part s’ils ne se sentent pas bien. Ils s’y rendent plutôt au moment des pauses, à midi ou à 16 heures », remarque Anne-Laure Marin. « Je pense qu’il faut faire confiance aux salariés : plus les entreprises le feront, plus on le leur rendra », partage dans le même sens Mathilde.
Élisabeth Crépin-Leblond 
*Les prénoms ont été modifiés.